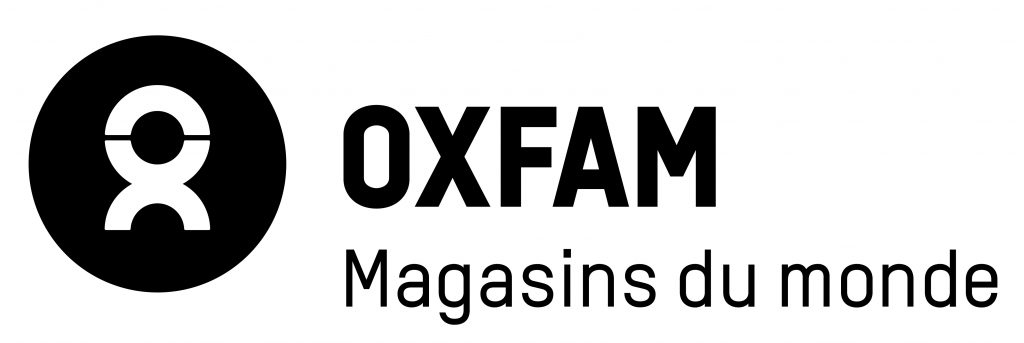Résumé
À l’approche des élections locales en Belgique d’octobre 2024, Agroecology in action (AiA) présente ses mesures prioritaires pour contribuer à la nécessaire transition agroécologique et demande aux partis politiques de les intégrer dans leurs programmes.
- Développer la démocratie alimentaire au niveau local
- Protéger la terre et les ressources naturelles et soutenir l’installation de nouveaux·elles paysan·nes
- Garantir le droit à l’alimentation et à la nutrition pour tou·tes
- Promouvoir des modes de consommation agroécologiques
- Réduire les inégalités de genre pour favoriser la transition agroécologique
———————
Développer la démocratie alimentaire au niveau local
Le système agroalimentaire actuel se caractérise par une mondialisation toujours plus importante des chaînes d’approvisionnement et une concentration du pouvoir aux mains de quelques géants de l’agro-industrie et de la grande distribution. Ce modèle non démocratique s’accompagne de nombreux impacts négatifs sur l’environnement (ex. changement climatique, destruction de la biodiversité, pollution des eaux et des sols), sur la santé (ex. scandales sanitaires à répétition, obésité, maladies cardio-vasculaires) et sur les conditions sociales (ex. baisse des prix et étranglement des petit·e·s producteur·rice·s, accaparement des terres, conditions de travail précaires), comme l’ont notamment illustré les récentes mobilisations agricoles.
Il est urgent d’opérer une transition vers la souveraineté alimentaire, c’est-à-dire le droit et le devoir pour les citoyen·ne·s, les petit·e·s producteur·rice·s et les acteur·rice·s à la base du système agroalimentaire de discuter et décider : du type d’alimentation qu’ils et elles désirent ; de son mode de production ; et comment, ensemble, ils et elles peuvent gérer ce bien commun qu’est l’alimentation. L’échelon local (communes, villes et provinces) nous semble particulièrement adéquat pour donner ce pouvoir aux citoyen·ne·s et refonder les systèmes agroalimentaires à partir de la base, en adéquation avec les enjeux locaux.
C’est pourquoi nous demandons aux pouvoirs publics locaux :
- De créer des lieux de débats entre agriculteur·rice·s, citoyen·ne·s et acteur·rice·s de l’alimentation pour construire ensemble des projets pour l’agriculture et l’alimentation de leur territoire. Ces lieux de débats peuvent être de plusieurs types :
- Dans une commission d’agriculteur·rice·s, au sein de la Commission locale de développement rural, ou au sein de toute autre commission pouvant être créée pour ce faire.
- En étant soutenant et présent activement au sein : des Conseils de politiques alimentaires (CPA) locaux[1] ; des Groupes d’action locale, ou des Parcs naturels/nationaux, dans les groupes de travail orientés vers l’agriculture et l’alimentation ; des Ceintures alimentaires et/ou Maisons de l’alimentation.
- En résultat ou en parallèle de ces débats, d’adopter une stratégie communale de soutien aux agriculteur·rice·s, à la transition agroécologique et l’alimentation locale et solidaire. Cette stratégie doit définir des objectifs et des indicateurs précis permettant aux citoyen·ne·s de faire un suivi et un contrôle des engagements[2].
- D’adopter la Charte des communes paysannes du Mouvement d’Action Paysanne (MAP), qui implique de communiquer et de faire appliquer au niveau local le contenu de la « Déclaration des Nations unies pour les droit des paysan·ne·s et des autres personnes travaillant dans les zones rurales » (UNDROP, 2018)[3].
- De souscrire à des engagements internationaux tels que La déclaration de Glasgow sur l’alimentation et le climat. Lancée lors de la COP26 à Glasgow en 2021, elle constitue un engagement novateur sur le rôle des systèmes alimentaires locaux dans la lutte contre le changement climatique, ainsi que sur le rôle des villes dans la réalisation de cet objectif. Actuellement, en Belgique, des villes comme Liège, Leuven, Bruges et Gand ont déjà signé cette déclaration.
Protéger la terre et les ressources naturelles et soutenir l’installation de nouveaux·elles paysan·ne·s
Les terres agricoles et les autres ressources naturelles (eau, semences, forêts…) constituent la base d’un système agricole résilient et durable. Mais les ressources foncières en Belgique sont menacées par l’urbanisation, l’artificialisation des terres (pour le logement, les projets d’infrastructures, les zones d’activité économique) et des usages autres que la production de nourriture (élevage de chevaux, sapins de Noël, biométhanisation, agrivoltaïsme).
De fait, les terres agricoles font également l’objet de spéculation et de marchandisation. Les terres agricoles belges sont les deuxièmes plus chères d’Europe et deviennent par conséquent inaccessibles pour les petit·e·s producteur·rice·s, en particulier les jeunes et les nouveaux·elles paysan·ne·s[4]. Les terres sont également menacées par la pollution et l’érosion dues à l’urbanisation conjuguée à des activités industrielles et d’agriculture intensive.
Par ailleurs, les campagnes se vident de leurs fermes et de leurs agriculteur·rice·s, faute de repreneur·euse·s. En effet, la majorité des agriculteur·rice·s sont aujourd’hui âgé·e·s de plus de 55 ans. 67% vont prochainement quitter la profession, dont 80 % sans repreneur ou repreneuse. Le risque est donc grand que ces fermes et terres soient acquises par des fermes toujours plus grandes, par l’agro-industrie ou des acteur·rice·s externes à l’agriculture, engendrant accaparement, concentration foncière et disparition des agriculteur·rice·s indépendant·e·s. C’est donc la perte d’une agriculture ancrée localement et en lien avec les autorités locales.
Les acteur·rice·s politiques locaux connaissent généralement bien leur population agricole ; ils et elles peuvent être attentif·ve·s et porteur·euse·s de politiques de soutien à la préservation de ces fermes. Les pouvoirs locaux, qui possèdent 8% des terres agricoles, ont un rôle important à jouer pour protéger les terres agricoles et favoriser un accès pour le renouvellement des générations et le soutien de projets agroécologiques.
C’est pourquoi nous demandons aux autorités locales :
- D’adopter une politique foncière communale au service de l’agroécologie, en commençant par établir un cadastre des terres publiques de la commune (si ce n’est pas déjà fait). Ces terres constituent un précieux patrimoine à préserver pour les générations actuelles et futures et ne doivent en aucun cas être vendues. Elles doivent être gérées de manière transparente et attribuées selon des critères permettant de soutenir la transmission des fermes, l’installation des jeunes et la production alimentaire et agroécologique locale.
- D’adopter des politiques locales d’aménagement du territoire (notamment dans le cadre du schéma de développement communal) visant à préserver les terres agricoles et leur fonction nourricière. Les projets d’infrastructure indispensables pour la collectivité (ex. photovoltaïsme) doivent être réalisés sur des sites déjà artificialisés et non se faire aux dépens des terres agricoles et des espaces verts.
- D’être pro-actives pour développer une politique de transmission des fermes et d’accompagnement des cédant·e·s, en soutenant prioritairement les jeunes et la transmission des fermes.
- Vérifier le respect de l’interdiction d’utilisation des pesticides pour la gestion des espaces publics et développer des programmes communaux, en concertation avec les agriculteur.rice·s et les citoyen.ne·s, pour aller vers des communes « zéro phyto. En particulier sur les terres communales proches d’habitations ou de bâtiments de collectivités (écoles, crèches, maisons de repos…) et de restreindre strictement l’utilisation chez les professionnel·le·s et les particulier·ère·s. À cet égard, les autorités locales disposent de plans d’action pour la nature pour mettre en œuvre notamment les décisions du gouvernement wallon sur l’interdiction de l’utilisation du glyphosate et des pesticides contenant des néonicotinoïdes par les particuliers.
- De soutenir les productions locales dans les cahiers des charges alimentaires des collectivités publiques.
Spécifiquement, pour soutenir l’installation de nouveaux·elles paysan·ne·s et soutenir la transition agroécologique, nous recommandons aux autorités locales de :
- De faciliter les démarches d’installation paysanne en disposant de services compétents (à l’échelle communale, pluri-communale, ou d’un GAL) permettant de soutenir toute démarche de reprise ou d’installation de fermes, en particulier agroécologiques et nourricières.
- De soutenir et renforcer les coopératives paysannes locales permettant une mutualisation des moyens et des savoirs/compétences entre paysan·ne·s, par exemple en favorisant l’accès à des locaux gratuits et en accompagnant les coopératives grâce à l’accès à des ressources logistiques, humaines, de gestion et/ou financières.
- De soutenir les initiatives paysannes et citoyennes visant le développement de filières locales (ex. marchés, magasins) et de ceintures alimentaires locales, comme par exemple les initiatives de ceintures alimentaires dans les régions de Liège, Bruxelles, Charleroi, Verviers et du Brabant wallon[5].
- De reconnaître et promouvoir les systèmes de certification paysanne, comme par exemple les systèmes participatifs de garantie (SPG)[6], qui sont élaborés et fonctionnent en concertation entre les paysan·ne·s et les groupes de mangeur·euse·s. Au-delà de la certification, les SPG permettent à chacun·e de se réapproprier les clés de son alimentation.
Promouvoir des modes de consommation agroécologiques
La transition agroécologique ne concerne pas uniquement la production agricole. C’est l’ensemble de la chaîne alimentaire (de la fourche à la fourchette) qui doit être transformée pour répondre aux défis humains et environnementaux. De nombreuses initiatives citoyennes ont déjà montré la voie vers d’autres modes de distribution et de consommation, recréant un lien de solidarité entre paysan·ne·s et mangeur·euse·s. Mais d’après l’Observatoire de la consommation de l’APAQ-W, les circuits courts ne représentent encore que 7% des achats alimentaires. Ces initiatives doivent donc être davantage soutenues par les pouvoirs publics pour permettre un changement d’échelle et réussir la transition agroécologique. Parallèlement, les pouvoirs communaux doivent lutter contre la malbouffe et favoriser des environnements alimentaires sains.
C’est pourquoi nous demandons aux pouvoirs publics locaux :
- D’intégrer les produits locaux, agroécologiques, de commerce équitable dans les marchés publics alimentaires de restauration collective (ex. écoles, maisons de repos, CPAS). Les communes peuvent notamment rejoindre le « Green Deal Cantines durables » de la Région Wallonne, afin de durabiliser et relocaliser leur approvisionnement, ainsi que le programme « Le coup de pouce « Du local dans l’assiette« , un subside couvrant jusqu’à 50% du prix des repas en produits locaux et 70% en produits locaux et bio[7].
- De faire partie des communes pilotes qui soutiennent des expérimentations de sécurité sociale de l’alimentation (SSA), qui vise notamment la possibilité pour toutes et tous d’acheter des produits de qualité (c’est-à-dire agroécologiques) qui auraient été conventionnés, via une carte de type chèque-repas[8].
- D’envisager un approvisionnement direct pour les restaurations collectives à travers des régies agricoles communales, qui permettent de développer des activités de production et de transformation agricoles gérées directement par les communes (voir plus haut).
- D’appuyer la création de nouveaux marchés alimentaires pour les producteur·rice·s locaux·ales et envisager la création de marchés de gros intercommunaux favorisant l’approvisionnement auprès des producteur·rice·s locaux·ales et rémunérateurs pour les paysan·ne·s.
- De soutenir les alternatives à la grande distribution, telles que les groupements d’achats communs et solidaires à l’agriculture paysanne (GAC, GASAP) et les (super)marchés coopératifs.
En ce qui concerne la lutte contre la malbouffe et la promotion d’environnements alimentaires sains, nous recommandons :
- D’interdire la vente de malbouffe (aliments ultra transformés, riches en calories, sucres, acides gras saturés, sels, tels que snacks, sodas, certaines céréales petit déjeuner) dans les structures communales, en particulier les établissements de jeunes (écoles, maison de jeunes, structures sportives, etc.).
- De lutter contre la prolifération de fast-food en refusant la délivrance de permis d’exploitation pour des raisons de santé publique[9].
- D’interdire la publicité pour la malbouffe sur tous les affichages publicitaires communaux[10].
- De mener des programmes de sensibilisation visant à réduire la surconsommation (de viande et produits animaux industriels, produits trop gras, sucrés, et transformés de façon industrielle…) et de mettre en place des programmes de consommation de fruits et légumes bio et de saison dans les écoles[11].
Garantir le droit à l’alimentation et à la nutrition pour tou·te·s
En Belgique, 600 000 personnes, soit 5% de la population belge, ont eu recours en 2021 à l’aide alimentaire, tandis que 50% est en surpoids (16% en situation d’obésité).
Plusieurs communes et/ou CPAS de Bruxelles et Wallonie ont déjà pris cette problématique en mains, en :
- diversifiant l’offre alimentaire dans le cadre de l’aide alimentaire en y intégrant des produits frais et locaux de qualité ;
- révisant les cahiers des charges alimentaires afin d’offrir des produits alimentaires de qualité et en quantité adaptée aux besoins des consommateur·rice·s ;
- offrant une soupe-collation réalisée à partir de produits locaux à tous les enfants des écoles de leur territoire ;
- développant des projets d’insertion socio-professionnelle sur leurs terres et offrant une production locale à leurs citoyen·ne·s.
C’est pourquoi nous demandons aux pouvoirs publics locaux :
- De soutenir les services d’aide alimentaire existants (services de distribution de colis, restaurants sociaux, épiceries sociales) et de favoriser au maximum leur approvisionnement en produits de qualité et auprès acteur·rice·s du circuit-court ;
- De favoriser les collaborations et les partenariats entre tou·te·s les acteur·rice·s d’un même territoire (associations d’aide alimentaire et de lutte contre la précarité, CPAS, associations locales d’alimentation durable, producteur·rice·s locaux·ales, etc.).
- Organiser une gestion solidaire des excédents agricoles et des invendus.
- En tant que CPAS, de développer, notamment sur les terres publiques, des projets d’insertion professionnelle en lien avec la production agricole agroécologique et l’alimentation.
- De mettre en place des projets agroécologiques à finalité sociale (ex. projets de potagers collectifs, groupements d’achat commun, marchés locaux, sécurité sociale de l’alimentation).
- D’inclure dans les stratégies agricole et alimentaire locales (voir plus haut) une approche axée sur les environnements alimentaires. Cela signifie qu’une politique de renforcement de la demande doit tenir compte de manière holistique des environnements physique (ex. localisation des magasins, des produits en rayon), socio-culturel (ex. marketing, habitudes alimentaires), économique (ex. prix, capacités financières) et cognitif (ex. labels, informations sur les emballages) de l’achat alimentaire.
Réduire les inégalités de genre pour favoriser la transition agroécologique (et inversément)
Les femmes*[12] jouent un rôle moteur dans la transition vers des systèmes agroécologiques et doivent être mieux intégrées dans les politiques, à tous les niveaux. Par ailleurs, l’agroécologie tend vers une société plus juste socialement et a le potentiel de réduire les inégalités, notamment celles liées au genre.
C’est pourquoi nous demandons aux pouvoirs publics locaux :
- De mettre en place une budgétisation sensible au genre et d’intégrer les enjeux de genre dans les actions des communes.
- D’accroître la disponibilité, le caractère abordable et la qualité des services de soins aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées en investissant à grande échelle dans le secteur des soins dans les zones rurales (sans reproduire des inégalités de genre).
- D’accroître la disponibilité, le caractère abordable et la qualité des services d’aide pour les violences sexistes et sexuelles en milieu rural (centre de prévention, formation, appel d’urgence, aide psycho-sociale et juridique, logement d’urgence, etc.) spécifiques aux réalités du monde rural agricole (des personnes formées aux réalités des agricultrices telles que l’isolement, la dépendance économique/professionnelle au conjoint, les LGBT-phobies en contexte rural).
- De soutenir des groupes locaux d’agricultrices (via les centres culturels par exemple).
- D’organiser des événements culturels et des formations qui permettent aux femmes* de développer leur capacité de prise de parole afin qu’elles soient entendues lors des prises de décisions.
- D’organiser à fréquence régulière des formations à la dimension de genre pour le personnel et les bénéficiaires des services communaux.
Nous invitons tou·te·s les citoyen·ne·s partageant nos valeurs à nous communiquer leurs engagements en faveur de la transition agroécologique et à interpeller leurs candidat·e·s locaux·ales sur base de ces revendications pour rendre possible la transition agroécologique. Pour toutes questions par rapport à ce mémorandum veuillez contacter la coordination d’Agroecology in Action : renaud@agroecologyinaction.be.
[1] Les Conseils de politique alimentaire représentent un modèle de gouvernance collaborative qui a émergé dans les années quatre-vingt en Amérique du Nord. Fin 2023, il y avait en région wallonne 11 initiatives de CPA en cours, notamment à Liège, Namur et Charleroi, couvrant près de 70% de la population. Voir également : CPA : définition, raison d’être et balises méthodologiques (Canopea, 2022) ; Les Conseils de politiques alimentaires : Vers une gouvernance démocratique des systèmes alimentaires ? (FIAN, 2017).
[2] Voir à ce titre l’exemple de la commune de Plessé en France, qui a lancé en 2020 sa propre politique agricole et alimentaire communale (https://tinyurl.com/y9vhu9nj), notamment pour favoriser l’installation de jeunes en agriculture.
[4] Le prix de vente moyen d’un hectare de terre agricole en Wallonie a fait un bon de +33,7 % depuis que l’Observatoire des Prix du Foncier Agricole a été mis en place en 2017 (6 % l’an !). Il atteignait en 2022 36.368 euros/ha, tous types de superficies confondues. Source : Chiffres : rapport 2023 de l’Observatoire des Prix du Foncier Agricole.
[5] Les projets de ceinture alimentaire visent à dépasser les initiatives isolées en rassemblant les acteur·rices de la transition agroécologique, en identifiant les besoins prioritaires pour le développement des filières locales, en mutualisant les outils et savoir-faire et en développant des liens avec les mangeur·euses. Exemple à Liège : www.catl.be.
[6] Les Systèmes Participatifs de Garantie sont des systèmes d’assurance qualité orientés localement. Ils certifient les producteur·rice·s sur la base d’une participation active des acteur·rice·s concerné·e·s et sont construits sur une base de confiance, de réseaux et d’échanges de connaissances (définition IFOAM, 2008). Voir en Belgique les SPG du MAP (www.lemap.be/SPG) et du réseau des GASAP (www.gasap.be/spg-2), réunis au sein de la plate-forme SPG.
[7] Le financement total disponible est d’environ 800.000€, au bénéfice de 270 cantines, toutes signataires et dans la dynamique du Green Deal Cantines durables (qui comprend un total de 330 cantines).
[8] La sécurité sociale de l’alimentation peut permettre de garantir un large accès à une alimentation durable tout en sécurisant économiquement les alternatives de production agroécologique. Son expérimentation à large échelle doit se baser sur des principes de cotisation proportionnelle aux revenus, de redistribution universelle et de conventionnement démocratique vers des produits durables. Voir en Belgique notamment les expériences de la BEES coop ou de As Bean (www.collectif-ssa.be).
[9] Voir à cet égard les démarches qui sont faites en Flandre pour analyser les paysages alimentaires locaux et donner les moyens aux communes d’empêcher l’installation de chaînes de fast-food. RTBF, “La Flandre se mobilise contre les fast-foods à la campagne : la Wallonie est-elle à la traîne ?”, 7 août 2024.
[10] A l’exemple de la ville de Londres qui, sous l’impulsion de son maire travailliste Sadiq Khan, a interdit en 2019 la publicité pour la malbouffe dans les transports, avec comme résultats un recul de l’obésité de 4.8% en 4 ans et une réduction des cas de diabètes et de maladies cardio-vasculaires. ‘Interdire la pub pour la malbouffe’ (Tchak n°17, mai 2024).
[11] Voir par exemple le Programme ‘Lait, Fruits et Légumes à l’école’ (Progécole) qui permet de financer la consommation de fruits et légumes frais à l’école.
[12] Tout au long de ce document, le symbole “*” se référera aux femmes et pluralités de genres.