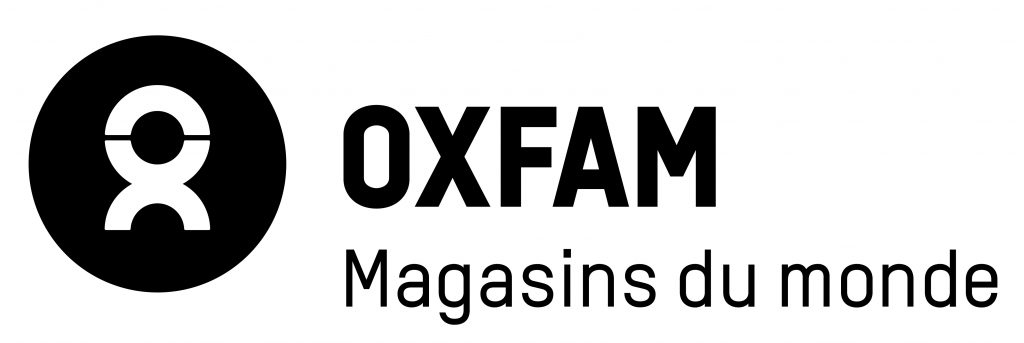Acheter ses vêtements en seconde main est souvent présenté comme un geste simple : un acte écoresponsable, bon pour la planète et pour le portefeuille. Mais derrière l’image positive d’un changement vertueux, la réalité est plus nuancée : cette pratique repose encore largement sur le temps, l’énergie et l’organisation des femmes. La lecture féministe permet de repenser ce déséquilibre pour mettre à jour les inégalités de genre et faire émerger une nouvelle façon de consommer qui déjoue les rapports de pouvoir et propose une autre alternative.
Symbole d’une mode durable et écologique, la seconde-main commence à s’imposer comme une alternative séduisante à la fast-fashion[1]. Le marché ne cesse de croitre. En Belgique, près de 40 % des personnes déclarent avoir acheté de la seconde main en 2023[2]. Les vêtements se trouvent en premier position de l’achat de seconde main, pour des raisons autant économiques qu’écologiques. Mais derrière cette tendance positive se cache une réalité moins rose : ce sont les femmes qui portent ces efforts.
Les femmes belges sont généralement plus nombreuses que les hommes à se tourner vers l’achat de seconde main[3]. C’est particulièrement marqué pour le cas des vêtements. La tendance dépasse les frontières : une enquête Harris Interactive révèle qu’en France, 61% des femmes se disent prêtes à acheter des vêtements de seconde main, contre 49 % des hommes[4]. Ce chiffre reflète un déséquilibre plus large : dans de nombreux foyers, « l’écologisation » des pratiques domestiques, du tri des déchets à l’achat de vêtements durables, repose majoritairement sur les femmes. Ce travail, souvent invisible, peut devenir une nouvelle forme de charge mentale.
Charge mentale
Le concept de charge mentale est développé en 1984 par la sociologue Monique Haicault pour comprendre comment les tâches ménagères sont réparties au sein du couple hétérosexuel. Il ne s’agit là pas tant de la réalisation de ces tâches en soi, que de la charge invisible associée à l’organisation, la gestion et la planification des tâches domestiques.
Aujourd’hui encore, cette charge repose principalement sur les femmes, qui doivent jongler entre vie professionnelle, tâches ménagères et charge familiale. Cela renforce les inégalités, y compris sur le marché du travail. La dessinatrice Emma l’illustre bien par la bande dessinée Fallait demander.
La charge mentale provient des normes sociales liées au genre, qui attribuent la responsabilité du foyer aux femmes, même lorsqu’elles travaillent à plein temps. En 2023, 41% des Belges pensent encore que les hommes font moins bien les tâches ménagères et s’occupent moins bien des enfants que les femmes (Eurobaromètre de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes).
La charge mentale et environnementale
Ce qu’on pourrait appeler une « charge environnementale » regroupe ainsi tous les efforts du quotidien pour réduire l’impact de nos modes de vie sur la planète : préférer la mode éthique, réparer plutôt que jeter, limiter la surconsommation… Autant de décisions quotidiennes, souvent invisibles, qui reposent très majoritairement sur les femmes.
Ce déséquilibre s’explique en partie par le fait que ces gestes touchent à la sphère domestique, traditionnellement dévolue aux femmes, mais aussi parce que les femmes se montrent généralement plus préoccupées par les questions environnementales[5]. Elles sont plus nombreuses à modifier leurs habitudes pour réduire leur impact, là où les hommes, même sensibilisés à la crise climatique, se montrent plus réticents à adopter des modes de consommation dits « éthiques », car ceux-ci sont socialement associés à la féminité[6]. Cette résistance est parfois renforcée par la croyance que les avancées technologiques (voitures électriques, innovations énergétiques, captation du carbone, etc.) suffiront à résoudre la crise, ce qui permet d’éviter les changements personnels et quotidiens jugés contraignants. Cette différence se reflète dans les chiffres : les hommes émettent en moyenne 5,3 tonnes de CO₂ par an, contre 3,9 tonnes pour les femmes[7].
En plus de porter la charge des gestes écologiques, les femmes sont aussi plus touchées par l’éco-anxiété, c’est-à-dire « l’appréhension et les inquiétudes quant à l’étendue potentielle des impacts du changement climatique et à l’incertitude de leur nature spécifique, de leur calendrier et de leur localisation précise »[8]. Cette éco-anxiété n’est pas forcément liée à une expérience directe d’un impact du changement climatique. Si l’éco-anxiété peut entrainer la mise en place de comportements plus éco-responsables, l’étude UCLouvain démontre qu’une éco-anxiété intense peut couper toutes capacités d’action.
Or les études montrent que le genre influence aussi la relation émotionnelle que l’on entretient avec la consommation, notamment dans la mode[9]. Les femmes sont plus nombreuses à intégrer les conséquences environnementales dans leurs décisions d’achat, ce qui alourdit encore la charge mentale. Chaque vêtement devient alors l’objet d’un arbitrage complexe entre besoin, coût, impact écologique et acceptabilité sociale.
Le privé est politique
Ce déséquilibre illustre parfaitement le principe défendu par Oxfam : le privé est politique.
Un des 11 principes féministes d’Oxfam :
Le privé est politique
« Nous reconnaissons que la lutte contre le patriarcat, la suprématie blanche, le racisme, le néolibéralisme et le colonialisme dans leurs différentes expressions (abus de pouvoir, exclusion et oppression…) commence par un questionnement et une remise en question personnelle. Nous faisons tous et toutes partie de systèmes plus larges et nos croyances, actes, attitudes et comportements peuvent soit renforcer l’injustice soit faire progresser l’égalité. Les transformations sociales, institutionnelles et individuelles sont étroitement liées. Nous reconnaissons qu’il n’y a pas de problèmes privés. »
Autrement dit, acheter en seconde main n’est pas seulement un acte individuel : il révèle et perpétue des rapports de pouvoir, des inégalités structurelles profondément ancrées dans notre société. Les problèmes individuels et quotidiens des femmes découlent du système politique oppressif dans lequel elles vivent. Le patriarcat cantonne les femmes dans la sphère privée, le travail de reproduction[10] invisible, non rémunéré et répétitif et désormais aussi écologique.
Réduire son empreinte écologique ne peut être présenté comme une simple affaire de volonté individuelle. C’est un enjeu politique, qui demande de repenser la place du travail domestique et de remettre en cause les normes de genre qui le façonnent, et de reconnaître que la responsabilité environnementale n’est pas répartie équitablement.
Une meilleure répartition des tâches entre les genres est nécessaire, mais pas suffisante. L’enjeu de la réduction de l’empreinte environnementale à travers des gestes comme l’achat de seconde main pose aussi la question de la sur-responsabilisation individuelle. Les comportements individuels ne relèvent pas seulement de choix personnels. Nos modes de vie sont façonnés par des facteurs structurels qui ne dépendent pas seulement de notre bon vouloir : infrastructures, organisation sociale et familiale, décision politiques, incitations économiques et fiscales, etc[11]. C’est pourquoi il est essentiel de soutenir politiquement le secteur de la seconde main, à travers des politiques publiques ambitieuses et des infrastructures solides, afin de lui donner les moyens d’atteindre son plein potentiel social et environnemental. Près de 75% des Belges déclarent en effet que les autorités devraient encourager davantage la seconde main et prendre des mesures fiscales pour rendre le réemploi encore plus intéressant[12].
Pour réduire nos déchets et préserver nos ressources, nous devons repenser nos modes de production dans leur ensemble. Adopter une approche féministe, c’est aussi s’émanciper de ce modèle productiviste qui privilégie l’intérêt économique au détriment de l’humain et de l’environnement. Défendre la seconde main, l’artisanat et d’autres formes de production locale et durable, c’est non seulement réduire notre empreinte écologique, mais aussi résister à un système qui perpétue les inégalités.
Noémie Galland-Beaune
Bibliographie
Lalanne, M. et Nathalie L. « L’engagement écologique au quotidien a-t-il un genre ? » Recherches féministes, volume 22, numéro 1, 2009, p. 47–68, https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2009-v22-n1-rf3334/037795ar/
Legrand, M, Réduire son empreinte écologique : une charge « environne-mentale » pour les femmes ?, Axelle Mag , https://www.axellemag.be/charge-environnementale-femmes/
Flèche S., Sénécal L., La charge mentale, une double peine pour les femmes. (s. d.). CNRS le Journal. http://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/dialogues-economiques/la-charge-mentale-une-double-peine-pour-les-femmes
Hyun Jung Park, Li Min Lin, Exploring attitude–behavior gap in sustainable consumption: comparison of recycled and upcycled fashion products, Journal of Business Research, Volume 117, 2020, Pages 623-628, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296318304004
Oxfam France, Fast fashion et slow fashion : définitions et enjeux, https://www.oxfamfrance.org/agir-oxfam/fast-fashion-et-slow-fashion-impacts-definitions/
Pew Research Center, Women, more than men, say climate change will harm them personally: http://pewrsr.ch/1Tks62M
Scientific American, Men Resist Green Behavior as Unmanly : https://www.scientificamerican.com/article/men-resist-green-behavior-as-unmanly/
The Conversation, Face à l’urgence climatique, méfions-nous de la sur‑responsabilisation des individus, https://theconversation.com/face-a-lurgence-climatique-mefions-nous-de-la-sur-responsabilisation-des-individus-116481
[1] « La fast fashion désigne une tendance très répandue dans l’industrie de la mode reposant sur un renouvellement ultra-rapide des collections. S’appuyant sur un rythme de production effréné et insoutenable, certaines enseignes de prêt-à-porter vont jusqu’à renouveler leurs collections toutes les deux semaines, voire moins. Cette mode « jetable » produite à moindre coût a des conséquences sociales et environnementales désastreuses. », Oxfam France, Fast fashion et slow fashion : définitions et enjeux : https://www.oxfamfrance.org/agir-oxfam/fast-fashion-et-slow-fashion-impacts-definitions/
[2] Près de trois quarts des belges trouvent que les autorités doivent encourager davantage les achats d’occasion, Enquête du bureau d’études iVOX pour le compte de 2ememain, Kringwinkel, Cash Converters et HappyTroc: https://www.2ememain-presse.be/pres-de-trois-quarts-des-belges-trouvent-que-les-autorites-doivent-encourager-davantage-les-achats-doccasion/
[3] « Les femmes sont également plus nombreuses (41,4 %) que les hommes (35,5 %) à se tourner vers les achats de seconde main. » Ibid.
[4] Les Français et l’industrie textile, Enquête Toluna Harris Interactive pour le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des Territoireshttps://harris-interactive.fr/opinion_polls/les-francais-et-lindustrie-textile/
[5] Pew Research Center, Women, more than men, say climate change will harm them personally: http://pewrsr.ch/1Tks62M
[6] Scientific American, Men Resist Green Behavior as Unmanly : https://www.scientificamerican.com/article/men-resist-green-behavior-as-unmanly/
[7] https://www.rtbf.be/article/empreinte-carbone-pourquoi-les-hommes-polluent-plus-que-les-femmes-11547981
[8] 1 Belge sur 10 souffre d’éco-anxiété sévère, UCLouvain https://www.uclouvain.be/fr/news/1-belge-sur-10-souffre-d-eco-anxiete-severe
[9] Harantová, V., & Mazanec, J. (2025). Generation Z’s Shopping Behavior in Second-Hand Brick-and-Mortar Stores: Emotions, Gender Dynamics, and Environmental Awareness. Behavioral Sciences, 15(4), 413. https://doi.org/10.3390/bs15040413
[10] Le travail de reproduction ou travail de soin regroupe des tâches diverses, de la garde d’enfants à l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ou atteintes d’une maladie physique ou mentale, en passant par tout un éventail de tâches domestiques quotidiennes. Dans le monde entier, les femmes réalisent plus des trois quarts du travail non rémunéré. En 2020, Oxfam a estimé que la valeur monétaire du travail de soin non rémunéré assuré par les femmes dans le monde s’élève à au moins 10 800 milliards de dollars par an, soit trois fois la valeur du secteur des technologies à l’échelle mondiale. Source : https://oxfambelgique.be/inegalites-economiques-hommes-femmes
[11] Face à l’urgence climatique, méfions-nous de la sur‑responsabilisation des individus, The Conversation : https://theconversation.com/face-a-lurgence-climatique-mefions-nous-de-la-sur-responsabilisation-des-individus-116481
[12] Près de trois quarts des belges trouvent que les autorités doivent encourager davantage les achats d’occasion, Enquête du bureau d’études iVOX pour le compte de 2ememain, Kringwinkel, Cash Converters et HappyTroc: https://www.2ememain-presse.be/pres-de-trois-quarts-des-belges-trouvent-que-les-autorites-doivent-encourager-davantage-les-achats-doccasion/