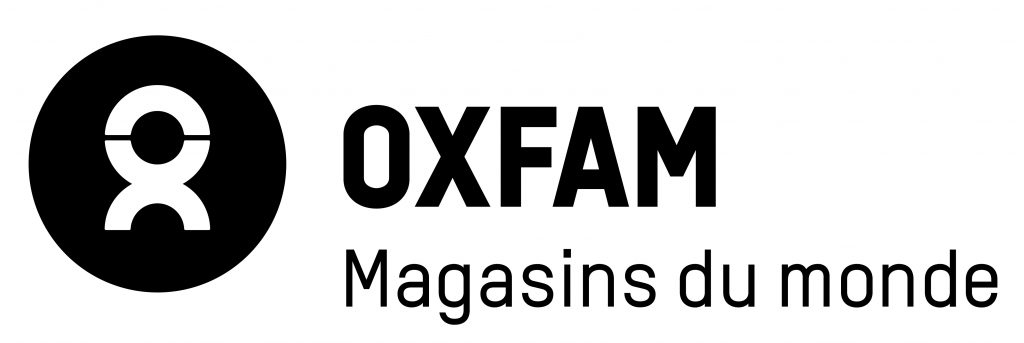Résumé
L’analyse présente l’agrivoltaïsme (association d’agriculture et de champs photovoltaïques sur la même terre) comme illustration des controverses sociétales autour de la transition. Promu comme étant une solution « win-win », l’agrivoltaïsme soulève des questions environnementales (coût panneaux, pollution, impact rendement variable) et, surtout, socio-économiques. En offrant des loyers bien supérieurs à l’agriculture, ces projets déstabilisent le foncier agricole, renchérissant les terres et rendant l’accès difficile pour les agriculteurs familiaux. Les cas d’Aiseau-Presles et Ineos poussent à questionner la finalité des installations. L’analyse critique ainsi le « technosolutionnisme », et part du principe qu’il ne suffit pas qu’une solution soit dite « renouvelable » pour qu’elle soit positive ; il faut la passer au filtre de questions essentielles : respecte-t-elle toutes les limites planétaires, répond-elle aux besoins fondamentaux du plus grand nombre, et ne creuse-t-elle pas les inégalités ? L’analyse démontre qu’il faut évaluer ces projets en considérant leur contexte global – social, économique, environnemental, et leur véritable utilité – pour ne pas se laisser aveugler par les promesses technologiques.
Si l’on peut considérer que la société humaine dans son ensemble a pris conscience de son impact énorme sur la planète, l’environnement et le climat, il lui reste à parcourir le chemin de l’action et des décisions concertées, de la mise en place des adaptations nécessaires et de la fameuse transition vers un monde plus durable. Or, ce chemin est semé d’embûches parmi lesquelles l’ambivalence des « solutions techniques » aux problèmes énergétiques et environnementaux. Ainsi, si certains secteurs vantent celles-ci et s’engouffrent dans les investissements et les marchés qui s’offrent à eux à travers ces technologies, d’autres pans de la société critiquent ces mauvais choix, leur impacts sociaux notamment, leurs limites et les faux espoirs qu’ils peuvent susciter. Exemple à l’appui au travers du cas de l’agrivoltaïsme et son impact sur le foncier agricole qui fut le thème choisi pour un action lors de la journée des luttes paysannes 2024 en Belgique francophone. Partant de ce cas particulier, la présente analyse propose quelques pistes de réflexions pour aiguiser notre sens critique face aux solutions technologiques mise en avant aujourd’hui pour décarboner nos sociétés et réaliser la transition dont tout le monde parle, mais dont personne ne sait vers où elle nous conduit exactement.
Le contexte de la journée des luttes paysannes 2024
En 2024, comme chaque année depuis dix ans en Belgique francophone, le Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (Résap[1]) a rejoint les manifestations qui éclosent à travers le monde autour du 17 avril, journée des luttes paysannes. Le Résap choisit généralement une thématique liée à l’agriculture et l’exemplifie par une lutte locale que le Résap initie ou soutient, en mobilisant autour et en médiatisant celle-ci.
En avril 2024, le choix s’est porté sur l’accès à la terre et la problématique de l’agrivoltaïsme : la commune d’Aiseau-Presles ayant introduit un recours contre la décision du fonctionnaire-délégué à la Région d’accorder un permis unique pour l’installation d’un champ de panneau photovoltaïque couplé à une activité apicole et d’élevage ovin sur une terre agricole. « Il est prévu d’installer 22 000 panneaux photovoltaïques sur 30 ha de terrain, ce qui représente 5% des terres arables de la commune. »[2]
Le Résap, qui regroupe certains syndicats agricoles et mouvements paysans, des associations environnementales, des ONG et des citoyen∙ne∙s, a organisé une manifestation à Aiseau-Presles, a publié une carte blanche dans la presse, a également rencontré le Ministre Borsu et la Ministre Tellier, alors respectivement en charge de l’agriculture et de l’environnement. A cette occasion, beaucoup de citoyen∙ne∙s (dont l’auteur de cette analyse) ont découvert le terme « agrivoltaïsme », ce qu’il signifie, et les projets en cours ou à venir en Wallonie.
Le recours contre le permis délivré a connu une fin heureuse pour la commune et les militant∙e∙s puisque le permis a finalement été bloqué par les deux cabinets Ministériels impliqués[3]. Mais au même moment, en France, sortait un nouveau décret destiné à encadrer (et permettre) les pratiques d’agrivoltaïsme. Partout dans le monde, sur tous les continents, des projets voient le jour.
A ce stade, si vous, lecteur, lectrice, n’avez jamais entendu parler d’agrivoltaïsme, vous serez tenté∙e de faire un tour rapide sur internet. En cherchant, vous vous demanderez rapidement si l’agrivoltaïsme est quelque chose de positif ou non pour notre planète, si comme le disent beaucoup, il s’agit d’un win-win agricole et énergies renouvables, si c’est aussi simple que cela ? Et si oui, pourquoi une commune et un réseau de dizaines d’associations a souhaité contrecarrer l’implantation d’un tel projet à Aiseau-Presles.
Le sujet de la présente analyse n’est pas de présenter l’agrivoltaïsme de manière technique et exhaustive mais de présenter de manière succincte les différents enjeux sociétaux et environnementaux que l’agrivoltaïsme suscite. Ensuite, il s’agit de mettre en évidence que l’agrivoltaïsme est une illustration somme tout assez parlante d’un nouveau paradigme auquel nous devons faire face actuellement, ou plutôt notre difficulté à concilier différents paradigmes, soit différentes manières de nous représenter une société durable amenée à trouver une nouvelle manière d’habiter le monde.
Mais avant tout chose, qu’est-ce que l’agrivoltaïsme ?
Une définition de l’agrivoltaïsme
L’agrivoltaïsme est une pratique qui existe déjà depuis plusieurs années et qui consiste à associer agriculture et photovoltaïsme, d’où le néologisme. Sur un même terrain, avec différentes techniques, on implante des panneaux photovoltaïques qui produisent de l’électricité et on exerce en même temps une activité agricole (culture, élevage, apiculture,…).
Posons d’emblée que pour parler d’agrivoltaïsme, il faut bien la conjonction de ces deux éléments. Nous sortons donc du périmètre de notre définition des panneaux qui seraient placés sur des terres en friches, de terrains pollués ou des terres non-fertiles, bétonnées. Également, nous n’incluons pas les panneaux solaires placés sur les toits des bâtiments[4], même agricoles, à l’exception peut-être des serres.
Il reste donc sous l’appelation « agrivoltaïsme », ces hectares de champs et prairies recouverts (à différentes hauteurs, selon différentes configurations) de panneaux photovoltaïques.
A ce stade, même si l’on s’accorde sur l’existence d’une activité agricole et de production d’électricité photovoltaïque, on peut se demander dans quelles proportions. L’une doit-elle être secondaire par rapport à l’autre comme dans la définition du législateur français :
« L’agrivoltaïsme désigne une pratique consistant à associer sur un même site une production agricole (maraîchage, élevage, vigne, etc.) et, de manière secondaire, une production d’électricité par des panneaux solaires photovoltaïques.
Les termes « agrivoltaïque », « agrophotovoltaïque » ou encore « solar sharing » en anglais sont également employés pour désigner ce concept »[5].
Si cette définition précise que la production d’électricité doit être secondaire, il n’est pas nécessairement aisé de l’observer dans la pratique avec des critères précis. On sent bien qu’on voudrait conserver l’effet « win-win » et que la production d’électricité ne doit pas oblitérer l’agriculture qui se pratique au même endroit. Mais l’on peut légitiment se demander si cela se produit réellement.
Parmi les avantages prônés par les tenants de l’agrivoltaïsme, citons:
- Un meilleur revenu (grâce à la revente de l’électricité produite) ;
- Une adaptation au changement climatique ;
- Une protection contre les aléas, intempéries (pour les animaux et/ou les plantes protégées par les panneaux).
Bien des questions environnementales
Pourtant, derrière le tableau idyllique de l’agrivoltaïsme se cache bien des interrogations.
D’un point de vue environnemental d’abord, il n’est pas anodin d’installer des hectares de panneaux sur une terre nourricière. Il faut bien sûr prendre en compte le coût environnemental de la production de ces panneaux qui va au-delà d’une simple empreinte carbone (qu’elle soit d’ailleurs jugée positive ou négative). Les métaux extraits sont responsables d’autres pollutions que celle uniquement liée au changement climatique par l’émission de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, les panneaux une fois installées vont potentiellement rester longtemps et peuvent causer une pollution par déchets et reliquats de métaux, plastiques ou microplastiques. Les panneaux ne viennent pas seuls, ils doivent être raccordés au réseau, ce qui peut supposer l’enfouissement de gaines et de câbles dans le sol. Souvent, la possibilité de remise du lieu dans son pristin état (et son coût inclus dans le contrat) est mise en avant pour défendre des projets agrivoltaïques et lever les inquiétudes, mais il est permis de se montrer prudent malgré tout[6].
Dans l’intrication entre production électrique et activité agricole, la présence des panneaux pose aussi question. Des recherches ont eu lieu et continuent afin de déterminer l’impact sur le rendement agricole. Les résultats sont mitigés et dépendent du contexte, il semble que sous un climat (qui change) plus chaud et plus instable, les panneaux peuvent protéger certaines cultures (comme les vignes de la grêle ou de la sécheresse, ou les animaux en apportant de l’ombre). Une entreprise comme Sunagri se targue en 2024 de permettre grâce à ses installations un rendement viticole de 30% supérieur ![7]
Mais d’autres sont plus prudents, préférant parler « d’hypothèses »[8]. Notons que l’argument des panneaux apportant de l’ombrage peut tout aussi bien plaider pour l’agroforesterie qui par ailleurs est aussi source de revenu (fruitiers, bois) comme le mentionne la Confédération paysanne en citant le directeur de l’association française d’agroforesterie : « La grosse différence entre l’arbre et le panneau, concerne l’ombre. Avec un arbre vous avez une ombre froide et humide et avec un panneau vous avez une ombre sèche et chaude, il suffit de se mettre sous un arbre et ensuite de se mettre sous un panneau métallique et voir la différence […] En terme de résilience, les pratiques agroécologiques de couverture du sol, d’amortissement climatique avec des arbres, de diversification en réduisant la monoculture et la densité de plantation des fruitiers apportent plus de sursis que des panneaux qui font de l’ombre chaude et sèche. »[9]
Certaines recherches montrent aussi que mettre des panneaux (qui captent une partie de la lumière du soleil) entraine automatiquement une diminution de la photosynthèse des plantations situées en dessous. A cela, la parade est déjà prête : panneaux pivotant pilotés, panneaux filtrants et laissant passer l’onde lumineuse nécessaire à la photosynthèse. La bataille du « pour » et du « contre » cette technologie est bien engagée.
Pour ne pas s’encombrer de ces considérations négatives, et pour davantage verdir de tels projets, on préfère implanter des panneaux et placer des moutons en dessous, parfois aussi, comme dans le cas d’Aiseau-Presles, avec des ruches, et agrémentées d’autres apports favorisant la biodiversité (plantation de haies, prairies fleuries pendant une partie de l’année,…).
A nouveau, on emprunte des techniques agroécologiques sans doute[10] bénéfiques pour l’environnement à l’appui d’un projet qui dans sa globalité pose question.
Par ailleurs, on comprend aussi que tout élément naturel ne cohabite pas nécessairement bien avec des panneaux solaires. Parmi les animaux d’élevage, seuls les moutons conviennent car les chèvres risquent de sauter sur les panneaux et les abimer, les vaches risquent d’y coincer leurs cornes et de dégrader l’installation. Les moutons plus paisibles sont par ailleurs de parfaites petites tondeuses naturelles qui éviteront une tonte mécanique régulière plus compliquée entre tous ces panneaux, et qui cautionnent donc très bien par leur présence « naturelle » la présence artificielle des panneaux dans le paysage.
A y regarder de plus près, l’agrivoltaïsme présentée comme une solution win-win, conservant et plaçant en premier lieu l’activité agricole, mais soutenue et même maintenue grâce à une production électrique « décarbonée », ne parait pas si limpide. Certains projets semblent avant tout viser à rentabiliser des hectares par une production électrique plus rentable plutôt que par de l’agriculture moins rentable. La FUGEA et la Confédération paysanne rappellent également que dans les faits les panneaux bloquent la possibilité de convertir les terres en d’autres usages : « Nous dénonçons le rapport de l’ADEME qui prône des projets agrivoltaïques « flexibles » et « adaptables » alors qu’il apparaît impossible qu’ils le soient dans les faits : si un·e paysan·ne décide de passer de l’élevage bovin à l’arboriculture de plein vent ou au maraîchage, les sociétés de PV – souvent des multinationales – viendront-elles changer la configuration des panneaux ? Bien sûr que non… »[11]
Et si même, sensibles que nous sommes à l’urgence écologique, nous estimons qu’il y a lieu de recourir au photovoltaïque et de le promouvoir fortement pour lutter contre le changement climatique, nous devrions à tout le moins nous montrer, ne serait-ce que d’un point de vue strictement environnemental, sceptiques et sélectifs par rapport à chaque projet constitué.
Placer des panneaux solaires sur des champs n’est donc pas (toujours ici uniquement d’un point de vue environnemental) la panacée écologique[12]. Le cas d’Inéos est également là pour nous rappeler d’être attentif au contexte plus global d’un projet agrivoltaïque et ses finalités.
L’exemple d’Ineos, se poser la question de la finalité.
Arrivé à hauteur de Jemeppe-sur-Sambre, le navetteur, la navetteuse lambda qui prend le train sur la ligne Namur-Liège peut depuis 2024 admirer un des plus grands champs photovoltaïques de Wallonie composé de 90.000 panneaux, soit l’équivalent de 56 terrains de foot recouverts selon l’entreprise Inéos elle-même[13].
Auparavant, notre navetteur/euse lambda aurait vu des champs (comme googlemaps le montre encore) sans doute loués à une exploitation agricole du coin. Mais ce terrain appartenait déjà à Inéos. En tant que propriétaire, Inéos est bien sûr libre de ne plus faire cultiver cette terre et d’introduire un permis pour y placer des panneaux.
« Bien, bien, ce n’est pas fort joli tous ces panneaux, mais il y a de l’espoir, la transition énergétique est en marche » pensera peut-être notre navetteur/euse imaginaire, loin d’imaginer que la totalité de l’électricité produite par ces panneaux servira uniquement à Inéos afin de diminuer ses besoins énergétiques de seulement 10%.
Mais que fait INEOS (sur son site « Inovyn » de Jemeppe-sur-Sambre) ? Réponse : de la pétrochimie, de la fabrication de vinyle. Et au-delà : « Fabricant mondial, INEOS exploite 194 sites dans 29 pays, génère 61 milliards de dollars par an et emploie plus de 26.000 personnes. En complément de son activité principale, INEOS est actif dans toute une série de sports d’élite et se fait de plus en plus connaître des consommateurs avec le lancement du Grenadier (un 4×4 sans compromis) et d’INEOS Hygienics »[14].
Merveille de la transition écologique en marche : 56 terrains de foot de terre agricole devenus champ photovoltaïque pour diminuer d’un petit 10% les besoins énergétique d’une usine de pétrochimie (qui ainsi investit sûrement pour faire des économies sur ces coûts de fonctionnement avant toute chose). Une entreprise dont le patron, milliardaire britannique, vante le succès de son 4×4 ultra-émetteur…[15]
Les cas d’Inéos est intéressant et exemplatif d’une « tâche aveugle » dans la promotion des projets d’agrivoltaïsme comme d’autres projets de production d’énergie « renouvelables » où l’on ne pose pas ou très peu la question de la finalité. A quoi doit servir l’électricité produite par ces panneaux, les efforts et les nouveaux projets mis en place actuellement vont-ils réellement remplacer les énergies dites fossiles ? Ou ne viennent-ils que s’ajouter au mix énergétique dont la consommation globale n’a à ce jour jamais diminué malgré toutes les innovations technologiques dites propres que l’on nous vend ?
Mais puisque nous avons décidé d’examiner la question de l’agrivoltaïsme en observant le contexte entier dans lequel cette « techno-solution » se déploie. Il est temps de sortir des considérations strictement environnementales des panneaux solaires, pour élargir notre point de vue au cadre socio-économique dans lequel la partie se joue.
Bien des questions socio-économiques
Pour un.e propriétaire qui loue ses terres agricoles, comme dans le cas d’Aiseau-Presles, l’implantation de panneaux photovoltaïques au rendement financier bien plus élevé par hectare que le rendement d’un bail à ferme par exemple, n’a rien d’une démarche anodine.
C’est une démarche qui participe à l’augmentation difficile à juguler du prix du foncier agricole. En Belgique, on estime que celui-ci a augmenté de 44% en 7 ans, pour un prix moyens actuel de près de 40.000 € l’hectare, voir beaucoup plus dans certaines régions[16].
En France, selon la Confédération paysanne : « Les loyers proposés aux propriétaires pour l’installation de centrales PV déstabilisent complètement le marché foncier, avec un rapport de 1 à 10 ou 30 pour le fermage (ex : 150€/ha vs 4000€ pour du PV) et de 1 à 3 ou 6 pour l’achat. Selon certains experts fonciers « considérant les taux proposés, un hectare de terrain couvert de panneaux avec un loyer de 2 000€/ha/an pourrait se valoriser entre 20 000 et 40 000 €/ha2 » quand le prix moyen à la vente des terres libres atteint 5 940€ l’hectare (données FNSAFER 2021) ».
C’est une des principales raisons pour lesquelles les associations, syndicats et citoyen.ne.s mobilisées en avril dernier à Aiseau-Presles scandaient « Des panneaux sur les hangars, pas sur nos hectares !», rappelant ainsi que la terre nourricière est un bien commun précieux qui ne peut être entièrement laissé aux mains du secteur privé et des dérives du marché foncier. Sinon sous peine de voir disparaitre rapidement et complément l’agriculture familiale et les bénéfices nombreux qu’une agriculture agroécologique promue et soutenue pourrait apporter.
L’argument du win-win économique de l’agrivoltaïsme, ne vaut en effet que pour un.e agriculteur/rice propriétaire de ses terres si l’idée lui venait de passer un contrat avec une société pour implanter des panneaux solaires. Et encore, si rentabilité promise à l’agriculteur/rice, il y a bien, celle-ci n’empêche pas que les terres agricoles dans les environs risquent de prendre de la valeur par des usages (agrivoltaïsme, élevage de chevaux, urbanisation…) qui sont autrement plus lucratifs. Spéculation, quand tu nous tiens !
Mais dans bien des cas, l’agriculteur/rice n’est que locataire de tout ou partie des terres, ou bien est un.e jeune qui voudrait pouvoir s’installer, ou reprendre une exploitation devenue inabordable. Entrer en compétition, en termes de rendement financier, avec une superficie servant à produire de l’électricité n’est pas possible, la somme obtenue par le propriétaire terrien pour louer sa terre pouvant vraisemblablement être multipliée par 10. Cela étant, l’avenir reste incertain quant à la rentabilité de ceux-ci de tels panneaux sur le long terme, tant le marché de l’énergie est susceptible d’évoluer nettement dans les années à venir.
La mécanique n’est pas seulement à l’œuvre dans nos contrées mais partout sur la planète. Un membre de la compagnie de théâtre-action Marbayassa au Burkina Faso, partenaire de Quinoa asbl, témoigne : « (…) un grand nombre de personnes d’ici n’ont pas accès à l’électricité pour diverses raisons. Et comme la production de l’électricité thermique est très chère et que nous avons abondamment du soleil, alors il y a une course effrénée pour la production de l’électricité solaire. Ce qui entraine l’occupation des vastes terres destinées à l’agriculture. Ainsi, bcp de paysans perdent leurs terres et tombent dans la précarité totale. Un autre problème d’occupation des terres s’est ajouté à l’envahissement des panneaux solaires. Il s’agit des sociétés immobilières qui achètent des centaines des hectares des terres agricoles pour construire des logements qu’ils revendent aux riches. Obligeant les paysans à quitter leurs terres pour se retrouver en chômage dans les grandes villes ».
Pour aller plus loin sur les conséquences de l’agrivoltaïsme sur le foncier, lisez le plaidoyer contre l’agrivoltaïsme du Résap[17] paru à l’occasion de la mobilisation à Aiseau-Presles.
Le techno-solutionisme à l’épreuve des enjeux sociétaux
Comme présenté en introduction, nous souhaitions présenter le cas de l’agrivoltaïsme comme illustration des paradigmes qui se déploient aujourd’hui autour de la transition écologique.
Des dizaines d’années ont été nécessaires pour arriver à la sensibilisation d’une part toujours plus importante de la population, des scientifiques, des décideurs/euses politiques et de toutes les sphères de la société à l’urgence climatique et plus largement à l’urgence environnementale.
Mais sitôt passé le cap[18] d’une prise de conscience globale planétaire, nous avons déchanté rapidement devant la multitude de choix, de dilemmes, de problèmes et de visions du futur qui divisent la société.
Si aujourd’hui, il semble qu’un consensus existe entre la plupart des nations (quand elles n’élisent pas des dirigeants climato-sceptiques) et du corps scientifique mondial, nous ne savons cependant pas nous mettre d’accord sur ce qui devrait structurer nos sociétés futures ayant fait œuvre de transition. Il est symptomatique à cet égard que les échos qui nous viennent des COP annuelles soient le plus souvent portés sur des grands montants d’efforts à payer pour l’adaptation au changement climatiques et des quotas de carbone à respecter, des limites à ne pas franchir, sans davantage nous présenter ce que cela va permettre de créer comme société.
Au-delà du monde militant climatique, des ONG spécialisées, et des centres de recherches qui planchent sur des scénarios de transition énergétique comme «The Shift Project », peu de citoyen.ne.s ne semblent aujourd’hui en mesure d’avoir une idée à peu près claire sur ce qu’il y a lieu de mettre en place, disons à un niveau étatique, pour créer une société bas carbone et écologique, et ce de manière structurelle, au-delà des « petits gestes individuels »[19].
Dans ce flou sociétal, les solutions climatiques de tous bords s’en donnent à cœur joie. Hi-tech contre low-tech par exemple, ou encore, solutions plus libérales (laissons place aux entreprises et aux investissements pour assurer la transition) ou plus « écologie politique de gauche » (reformons l’Etat et ses structures pour une société plus écologique et plus juste). On voit apparaitre des mouvements prônant la décroissance, la sobriété, et la justice fiscale (Taxons les riches) et de l’autre côté, des figures de milliardaires comme Elon Musk ou Jeff Bezos qui rêvent de prolonger la conquête spatiale en colonisant Mars[20], l’univers et ses ressources, tout en nous vendant du dernier cri technologique.
Au milieu du gué, une question cruciale devrait nous tarauder en permanence. Si nous pouvions y répondre ensemble, en société, nous pourrions peut-être faire avancer notre démarche vers la transition de manière plus rapide et efficace.
Cette question est en partie représentée par la théorie du Donut de Kate Raworth[21] qui utilise un schéma réconciliant limites planétaires et seuils minimaux pour une justice sociale. Mais l’on pourrait y ajouter une composante économique et une composante technologique qui sont deux facteurs qui aujourd’hui ont largement démontré que laissés sans contraintes, ils peuvent littéralement détruire la planète. Nous pourrions donc formuler la question comme suit :
« Quelle société construire aujourd’hui compte tenu d’une part des limites planétaires, d’autre part des besoins fondamentaux, de nos fonctionnements économiques et enfin de nos capacités technologiques ? »
Cette question englobe deux forces qui s’opposent : nos limites qu’il devrait être inacceptable de dépasser (bien que ce soit en partie le cas actuellement), mais aussi notre utilisation toujours plus poussée et répandue de machines gourmandes en ressources, et un système économique capitaliste (ou plus largement sociétal) permettant l’accumulation sans fin de richesses et les inégalités qui ne sont pas ou plus suffisamment bridées et corrigées par la fiscalité.
Cette question peut aussi servir de filtre à critiquer les diverses solutions ou innovations que l’on nous présente aujourd’hui. Avons-nous réellement besoin d’une société faite de voitures individuelles électriques ? De ferme 4.0[22] ? De smart cities ? De métavers ? De 5G ? D’agrivoltaïsme ?
Aujourd’hui, il n’est pas une société, une start-up, une entreprise qui ne surfe sur la vague du développement durable. A en croire l’entreprenariat du monde entier, nous ne cessons jour après jour d’inventer de nouvelles « solutions » pour le climat. Or, même les solutions écologiques qui nous semblent les plus prometteuses et fondées (comme planter des arbres à qui mieux mieux !) devraient être abordées avec un œil critique prenant en compte le contexte et les diverses composantes du problème, comme nous l’avons vu dans le cas de l’agrivoltaïsme.
Sans être exhaustif, lorsqu’une solution s’offre à nous, nous devrions pouvoir chercher la réponse à ces différentes questions :
-Cette solution contribue-t-elle effectivement à respecter l’ensemble des limites planétaires ? (Aujourd’hui nombre de solutions ne s’inquiète que de diminuer l’empreinte carbone qui ne correspond qu’à une seule limite planétaire).
-Cette solution contribue-t-elle effectivement à répondre aux besoins fondamentaux du plus grand nombre ? (Cette question peut distinguer les solutions techniques éminemment utiles, notamment dans l’agriculture, des solutions techniques qui semblent plutôt répondre à une envie de confort, de luxe, de rendement qui ne profite qu’à quelques-uns ou encore une mécanisation poussés à l’extrême… ).
-Cette solution est-elle de nature à renforcer les inégalités et à creuser davantage le fossé entre extrême richesse et extrême pauvreté ? (Peu de solutions « hi-tech » souvent très couteuses paraissent résister à cette question. Les vraies solutions résidant davantage dans une structuration sociétale plus sociale et inclusive).
-Cette solution est-elle une technologie qui demande l’exploitation de ressources non-renouvelables ? Auquel cas, nous savons qu’il n’est pas possible de compter dessus à long terme.
Face à ces questions, certaines technologies ne doivent clairement pas passer la rampe (comme les écrans publicitaires parfaitement inutiles dans les espaces publics, par exemple). Mais d’autres dont le bulletin est plus mitigé, font sûrement débat, ou sont à même d’initier des réflexions intéressantes sur la manière de les modifier pour qu’elles obtiennent de meilleurs points au test. Par exemple, on s’accorderait à dire que des voitures électriques individuelles connectées telles que proposées par Tesla sont une aberration. Mais quid de remplacer la voiture individuelle par un réseau de voitures électriques partagées ? Ou plutôt de construire dans un premier temps une société autour de transports en commun gratuits et au moins en partie décarbonés ?
On voit bien que l’agrivoltaïsme joue également dans ce jeu, dans lequel il devient aussi difficile de naviguer entre les « pour » et le « contre » qui sont parfois subtils. Si les panneaux étaient configurés pour vraiment être un allié de l’agriculture ? Si l’on s’assurait que ceux-ci profiteraient économiquement à l’agriculture familiale ? Si l’on conçoit des structures facilement démontables sans pollution ?
Nos biais technologiques
Nous souhaitions présenter l’agrivoltaïsme comme cas d’école pour illustrer la question plus vaste qui est celle de savoir comment nous abordons sociétalement la transition énergétique.
La réflexion sur les « pour » et les « contre » de l’agrivoltaïsme nous conduit à énoncer quelques biais cognitifs qui nous semblent souvent présents lorsque nous réfléchissons aux solutions concrètes à mettre en œuvre pour décarboner notre société, ou plus largement pour participer à la transition écologique et durable de nos sociétés.
Parfois un peu aveuglés par les beaux discours entourant ces solutions win-win, nous nous contentons en effet de :
- penser les technologies détachées du contexte socio-économique dans lesquelles elles pourraient se déployer.
- penser les technologies détachées du contexte environnemental plus large que juste celui de l’impact climatique.
- penser des solutions qui sont aussi autant de marchés, de produits vendus par des entreprises qui ont donc un intérêt clair à pousser celles-ci.
- penser des mesures écologiques uniquement destinées à conserver ou améliorer notre confort, en oubliant la possibilité de s’en passer et de faire plutôt le choix de la sobriété.
- penser les technologies comme un ingrédient incontournable des solutions
- mettre en avant les technologies hi-tech plutôt que low-tech.
Concernant l’agrivoltaïsme, il est symptomatique de voir que les projets sont souvent présentés sous l’angle de la production d’électricité renouvelable comme solution au changement climatique, et non la partie « agriculture » qui pourtant pourrait être une composante essentielle de la lutte contre le changement climatique (si effectuée de manière différente de l’agriculture industrielle), sans doute à certains égards bien plus importante que la production d’électricité décarbonée[23].
Conclusion
La présente analyse souhaitait à travers l’exemple de l’agrivoltaïsme mettre en évidence les nouveaux paradigmes auxquels la société est aujourd’hui confrontée. Après une période de « montée en conscience » de l’urgence environnementale, nous voici dans l’ère du tâtonnement quant aux solutions (ou plutôt adaptations) à mettre en place.
Dans cette ère, nous pouvons observer tous les bords de la société défendre leur vision de la transition. Certains mouvement et organisations de la société civile prennent ces problèmes complexes à bras le corps, comme The Shift Project, le mouvement des Villes en transition, les Doughnuts Economics Action Lab[24], et la myriade de chercheurs/euses qui œuvrent sur différentes thématiques, sur différents scénarios à travers le monde.
Le monde de l’industrie et de l’entreprenariat n’est pas en reste avec des initiatives allant d’une réelle prise en compte des problèmes aux pratiques de greenwashing les plus éhontées.
Les partis politiques quelles que soient leurs couleurs, après avoir méthodiquement récupéré à leur compte l’écologie politique qui étaient auparavant l’apanage unique des partis « verts », choisissent également leur camp soit en assumant ou en fustigeant les changements nécessaires proposés par les défricheurs/euses de la transition selon qu’ils apparaissent acceptables ou non pour leur électorat. On ne s’étonnera pas de voir la droite et l’extrême-droite casser du sucre sur le dos de l’écologie dite punitive, ou sur les discours prônant la décroissance.
Et puis, au milieu du brouhaha politique et médiatiques, les citoyen.ne.s se font leur propre opinion en fonction de leur sensibilité aux différents discours tenus. Même les plus avertis de la crise climatique ne peuvent peut-être s’empêcher de regarder du côté des solutions technologiques et espérer y trouver un certain espoir et réconfort face à l’ampleur de la tâche. Dans les pays riches, la vision est tentante de penser que nous pourrions dans 20, 30 ou 40 ans faire évoluer nos modes de vies vers une plus grande symbiose avec notre planète tout en conservant un mode de vie proche de celui que nous avons aujourd’hui, que la transition se fasse sans trop de heurts, sans trop d’efforts, sans trop de casse.
Les solutions technologiques qui se présentent à nous sous le prisme souvent fort simplifié du « renouvelable » ou du « décarbonné », apparaissent alors comme plutôt justifiée, engageante voire exaltante.
Peut-être préférons nous (et nos dirigeant.e.s) la paresse intellectuelle de se laisser bercer par le « green marketing » des vendeurs de nouveautés , plutôt que de mesurer pleinement les efforts nécessaire et le chemin à parcourir ensemble, avec tous les choix politiques, systémiques et holistiques qui s’imposent.
Dans cette bataille des idées, qui sera vainqueur ? Le capitalisme pourra-t-il encore longtemps récupérer à sa sauce les grands chantiers écologiques à mener, grâce aux promesses et aux paillettes des nouvelles technologies ?
Simon Laffineur
Notes
[1] Le site internet du Résap : https://www.luttespaysannes.be/
[2] https://www.luttespaysannes.be/mobilisations/nos-actions-passees/17-avril-2024/article/argumentaire-2024-plaidoyer-contre-l-agrivoltaisme
[3] Vous pouvez en savoir plus sur le site du Résap.
[4] Mais mettre des panneaux sur les bâtiments agricoles reste possible, et constitue une alternative parmi d’autres à l’agrivoltaïsme. C’est notamment ce que prône la Confédération Paysanne, sous certaines conditions cependant, afin de ne pas permettre à la production d’énergie de davantage précariser la production agricole – Confédération Paysanne, « NOUS NE TOMBERONS PAS DANS LE PANNEAU DE L’AGRIVOLTAÏSME ! Positionnement quant au photovoltaïque sur les terres agricoles naturelles et forestières », https://www.confederationpaysanne.fr/mc_nos_positions.php?mc=985
[5] https://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies/agrivoltaisme-en-france-de-quoi-sagit-il-et-que-change-le-decret-davril-2024 (août 2024) – Il n’existe pas de définition du législateur wallon à ce jour concernant l’agrivoltaïsme, seules des circulaires ministérielles en font mention. La législation urbanistique wallonne n’en fait pas un concept détaillé.
[6] On parle de contrats sur 20 ou 30 ans, ce qui laisse place à divers aléas avant un enlèvement effectif des panneaux.
[7] https://sunagri.fr/vendanges-2024-30-de-rendements-grace-a-lagrivoltaisme/ (décembre 2024)
[8] https://www.connaissancedesenergies.org/questions-et-reponses-energies/agrivoltaisme-en-france-de-quoi-sagit-il-et-que-change-le-decret-davril-2024 (août 2024)
[9] Fabien Balaguer directeur de l’Association française d’agroforesterie. Contre l’agrivoltaïsme, l’autonomie paysanne, journal L’Empaillé automne 2022.
[10] « Sans doute » parce que la mise en place de doivent toujours être appréciées dans un contexte donné plus large. Le cas d’Aiseau Prelses en donnait un bon exemple, un apiculteur de la région étant alarmé par le projet qui prévoyait l’installation de ruches, estimant que lui et ses confrères n’avait pas été prévenu et/ou consulté et qu’il fallait pouvoir prévoir que l’environnement puisse suffisamment subvenir aux besoins de toutes les abeilles présentent sur les lieux. Moralité : rajouter des ruches quelque part n’est pas nécessairement uniquement bénéfique.
[11] Confédération Paysanne, « NOUS NE TOMBERONS PAS DANS LE PANNEAU DE L’AGRIVOLTAÏSME ! Positionnement quant au photovoltaïque sur les terres agricoles naturelles et forestières », https://www.confederationpaysanne.fr/mc_nos_positions.php?mc=985
[12] Ceci étant, reconnaissons que d’autres usages de la terre agricole sont critiquables également et peuvent être pires que celui de l’agrivoltaïsme (agrocarburants, biométhanisation) ou meilleurs mais critiquables pour autant (éolien).
[13] https://www.ineos.com/fr/sites/belgium/news-index/un-parc-solaire-de-90.000-panneaux-et-de-60-mw-sera-mis-en-service-en-2024-en-belgique-pour-ineos-inovyn/ (décembre 2024)
[14] Ibid.
[15] https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/08/06/le-succes-paradoxal-du-grenadier-ineos-ce-4-4-ultra-polluant-fabrique-en-france_6184605_3234.html (décembre 2024)
[16] https://www.luttespaysannes.be/mobilisations/la-journees-des-luttes-paysannes/article/plaidoyer-les-societes-de-gestion-une-arme-feodale-au-service-du-capital
[17] https://www.luttespaysannes.be/spip.php?article291#2 (décembre 2024)
[18] L’avons-nous même réellement passé ? Il est permis d’en douter vu l’important backlash climato-sceptique de l’extrême-droite et de certains dirigeants.
[19] Nuançons ce propos. Enormément de chercheurs, chercheuses se penchent sur ces questions, et travaillent d’arrache-pied pour entrevoir le monde de demain. Mais, sans doute en partie à cause du manque de consensus politique autour des ces questions, les citoyen.ne.s restent dans le flou.
[20] A lire pour aller plus loin : Sylvia Ekstrom, « Nous ne vivrons pas sur Mars, ni ailleurs ».
[21] https://www.kateraworth.com/doughnut/ (décembre 2024) et voyez aussi la campagne d’Oxfam-Magasins du monde sur l’économie du donut : https://oxfammagasinsdumonde.be/campagnes/donut/
[22] Pour découvrir l’agriculture dite « 4.0 » voyez par exemple : https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2018/feb/agriculture-4-0–the-future-of-farming-technology.html (décembre 2024)
[23] Sur la question de la transition agroécologique et de l’équilibre à chercher pour l’usage de la terre entre fonction nourricière et autres fonctions (comme celle de produire de l’énergie), voyez le récent rapport du Shift Project : https://theshiftproject.org/article/pour-une-agriculture-bas-carbone-resiliente-et-prospere-the-shift-project-publie-son-rapport-final/ (décembre)
[24] https://doughnuteconomics.org/ (décembre)