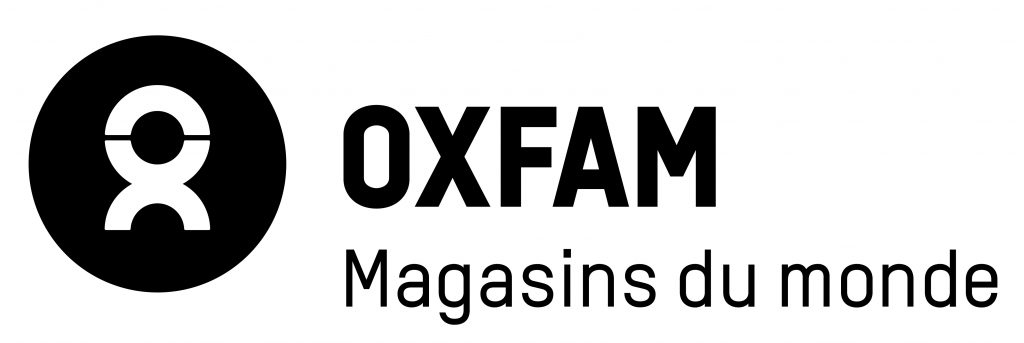Résumé de l’analyse
Les femmes portent le mouvement du commerce équitable, en Belgique et dans le monde. Elles représentent 65% du personnel salarié d’OMdm ; 90% des bénévoles adultes et 75% des bénévoles jeunes d’OMdm ; 56% du personnel de direction de nos organisations partenaires ; et 70 à 80% des artisan·e·s qui créent les produits de nos organisations partenaires d’artisanat. Toutes ces femmes vivent une forme d’empouvoirement, à travers leur engagement dans le mouvement du commerce équitable. Elles partagent souvent leurs combats, leurs difficultés, mais aussi leur volonté d’émancipation et de changer les règles d’un jeu patriarcal et capitaliste décomplexé.
Introduction
En 2025-2026, Oxfam-Magasins du monde a décidé de mettre en lumière le travail des femmes, qui portent en (grande) majorité le mouvement mondial du commerce équitable ; et d’affirmer haut et fort que le commerce équitable est un levier (parmi d’autres) d’émancipation, ou d’empouvoiremnt, des femmes dans le monde.
Mais qu’est-ce que c’est, l’empouvoirement ? Et, concrètement, dans quelles dimensions les femmes se trouvent-elles « empouvoirées », en s’impliquant dans le mouvement mondial du commerce équitable ? Explications.
Empouvoi-quoi ? « Pouvoir d’agir », « pouvoir intérieur », « pouvoir collectif »
Empowerment, empoderamiento, et maintenant, empouvoirement[1]… Ces néologismes font parfois frémir les puristes de la langue, ils sont pourtant d’une simplicité exemplaire. Ils sont construits sur la racine de en-pouvoir, c’est-à-dire, gagner, acquérir du pouvoir.
Préalable nécessaire : le mot « pouvoir » fait peur. Testez autour de vous. Demandez à des proches de penser à « une personne de pouvoir » et puis, demandez-leur d’associer des qualificatifs ou des mots-clés à cette « personne de pouvoir ». Presque toujours, vous entendrez : tyran, harcèlement, Hitler, micro-management… Ça fait froid dans le dos. Pourtant, quand on cherche la définition de « pouvoir », on s’aperçoit qu’on est loin du compte :
Avoir une certaine forme de pouvoir, c’est être en capacité d’action, de décision, de choix, de recevoir/accepter/refuser des opportunités, d’accéder et de gérer des ressources (financières, mais aussi matérielles : p.e. cultiver la terre de sa famille ou hériter d’un bien immobilier). Bref, avoir du pouvoir, c’est avoir prise sur les choses.
Est-il nécessaire de le rappeler ? Les femmes ont été et sont encore privées de pouvoir dans des contextes très différents, partout dans le monde. Certains exemples « évidents » viennent en tête. En Belgique, par exemple, les femmes ont été légalement privées de nombreux pouvoirs pendant longtemps : celui de voter et de s’impliquer juridiquement[2], celui de gérer leur argent[3], celui de disposer de leur corps selon leur volonté propre[4], etc. Mais « avoir du pouvoir », ce n’est pas strictement équivalent à « avoir des droits accordés par la loi ». Dans les sociétés humaines, de nombreuses formes de pouvoir ne sont pas circonscrites par des lois. Qu’en est-il de pouvoir accéder à des postes de direction et décision[5] au-delà « d’avoir le droit de travailler » ? De fréquenter des espaces publics en se sentant en sécurité[6] ? De disposer de données précises et ciblées sur sa santé, ainsi que d’aborder ses problèmes de santé avec des professionnel·le·s en étant certain·e d’être pris·e au sérieux, d’être adéquatement diagnostiqué·e et traité·e sans préjugés[7] ?
Le « pouvoir » recouvre des dimensions plus fines que le « droit ». Quand on parle d’empouvoirement (ou d’empowerment), on parle d’émancipation, de pouvoir libérateur (individuel et collectif), pour une société égalitaire et juste pour toutes les citoyennes et tous les citoyens. On identifie généralement trois dimensions de l’empouvoirement : le « pouvoir d’agir », le « pouvoir intérieur », et le « pouvoir collectif »[8].
En ce qui concerne le « pouvoir d’agir » (ou pouvoir de), il s’agit de la capacité des femmes[9] à prendre des décisions, à résoudre des problèmes, et à réaliser ses projets. Il s’agit de l’augmentation de l’autonomie individuelle et de la capacité à agir sur son environnement (personnel, professionnel, dans son milieu social, pour sa santé…)
En ce qui concerne le « pouvoir intérieur », il s’agit du renforcement de la confiance en soi, de l’estime de soi, et de la conscience de soi des femmes. Il s’agit de l’intériorisation d’une identité forte et de la capacité à se réaliser en tant qu’individu. Concrètement, cela peut être oser s’exprimer en public, souhaiter se visibiliser dans certains milieux, etc.
En ce qui concerne le « pouvoir collectif » (ou pouvoir avec), il s’agit de mettre l’accent sur la capacité des femmes à travailler ensemble, à se mobiliser collectivement, et à créer des réseaux de soutien. Ceci implique la participation à des mouvements économiques, sociaux, politiques ou de solidarité, en collaboration avec d’autres femmes, dans la construction d’une force collective pour défendre leurs intérêts.
En résumé, l’empouvoirement des femmes implique un renforcement de leurs capacités individuelles, de leur confiance en elles et de leurs actions collectives, dans le but d’atteindre l’égalité des sexes et de transformer la société pour qu’elle soit plus juste pour toutes et tous[10].
Où sont les femmes ? Dans le mouvement du commerce équitable
Les femmes et les hommes vivent encore, dans de très nombreux contextes, une division genrée du travail. En Belgique, comme ailleurs, les professions plus valorisées et rémunératrices sont largement occupées par des hommes ; tandis que les professions moins valorisées et rémunérées sont très largement occupées par des femmes[11]. En 2022, en Belgique, on avait ainsi dans le top 5 des professions les plus rémunérées : directeurs généraux d’entreprises (70% d’hommes)[12], directeurs dans l’informatique (80% d’hommes)[13], managers de services administratifs, médecins, secteur de la vente de la publicité (trois secteurs davantage paritaires en termes d’emploi, mais qu’il faut décomposer en fonction des spécialités)… Et dans le top 5 des professions les moins rémunérées : gardes d’enfants (plus de 95% de femmes), serveuses et barmen (très féminisé pour les serveuses), coiffeuses et esthéticiennes (90 à 95% de femmes), aides de ménage (plus de 90% de femmes) et caissières (plus de 85% de femmes)[14]…
Le commerce conventionnel ne fait pas exception. Il est massivement pourvoyeur de dérégulation de chaines du travail, de droits faibles, de protection sociale inexistante, de salaires insuffisants, etc. Notamment dans l’artisanat, au niveau mondial, secteur massivement employeur de main-d’œuvre féminine[15].
Dans le mouvement du commerce équitable – et notamment d’artisanat – , nous constatons un investissement féminin massif. Les femmes qui travaillent, d’un bout à l’autre de la chaine d’approvisionnement du commerce équitable, sont (très) majoritaires, et occupent des positions très diverses. En ce qui concerne directement la chaine d’approvisionnement d’Oxfam-Magasins du Monde[16], les femmes représentent :
- 70 à 80% des artisan·e·s qui créent les produits de nos organisations partenaires ;
- 56% du personnel de direction des organisations fournisseuses d’artisanat et d’alimentation – mais 68% quand on regarde les organisations fournisseuses d’artisanat[17];
- 65% du personnel salarié en Belgique d’OMdm ;
- 90% des bénévoles adultes d’OMdm ;
- Environ 75% des bénévoles jeunes (JM Oxfam) et environ 65% des enseignant·e·s qui mobilisent et animent ces JM en école secondaire.
Les femmes sont également largement présentes dans les instances internationales du mouvement du commerce équitable – par exemple, le comité de direction de l’Organisation Mondiale du Commerce Equitable (WFTO) compte 6 femmes, sur 9 membres.
Le commerce équitable se veut être un levier parmi d’autres d’émancipation des femmes. S’inscrire dans le mouvement du commerce équitable, qui promeut une logique d’empouvoirement, veut permettre aux femmes :
- De s’organiser autour d’un métier (de la production jusqu’à la vente, y compris via le bénévolat), d’apprendre et de valoriser leurs compétences (artisanales, entrepreneuriales ou dans le cadre d’un travail bénévole), de développer leur autonomie financière, etc. (« pouvoir d’agir ») ;
- De changer leur vision d’elles-mêmes, de réaliser sa capacité à influencer sa propre vie (« pouvoir intérieur ») ;
- De proposer ensemble une alternative au commerce conventionnel, à la fois dans leur propre contexte (d’une rémunération juste à l’accès à des postes à responsabilité, en passant par la valorisation de leurs savoir-faire, transformant ainsi petit à petit les normes d’un contexte local), mais également d’influencer collectivement les institutions politiques et commerciales dominantes en faveur d’un commerce juste, équitable, durable et inclusif, dans le monde entier (« pouvoir collectif »).
L’empouvoirement des femmes via l’engagement dans le mouvement du commerce équitable : deux profils, mais une réalité commune
Lors de l’été 2024, des interviews de représentantes d’organisations indiennes de commerce équitable[18] et des bénévoles adultes d’OMdm avaient été réalisées, pour mener à une étude sur la compréhension des concepts de genre et de féminisme au sein de notre base de bénévoles[19]. Dès ce moment, nous avons pu remarquer que des phrases très similaires, parfois presque au mot près, revenaient entre nos bénévoles et nos interlocutrices dans les organisations partenaires d’artisanat en Inde – quand bien même leurs activités au sein du mouvement du commerce équitable sont assez différentes (bénévoles pour les unes, communicantes ou responsables d’organisation exportatrice de commerce équitable pour les autres). Ces femmes, sans mettre dessus de mot précis, décrivaient une vision et des actions porteuses de « empouvoirement ».
Une autre confirmation de cette analyse nous est venue par les propos d’Anak Bunnak, directrice de l’organisation VillageWorks (Cambodge) – qui travaille avec 300 producteurs et productrices, dont environ 260 femmes rurales qui travaillent depuis chez elles et environ 40 personnes (hommes et femmes) porteuses de handicap physiques –, qui nous a accordé un entretien, lors de sa visite en Belgique, en mai 2025. Nous avons voulu mettre en parallèle les mots de nos bénévoles et ceux d’Anak Bunnak, afin de mieux comprendre de quelle façon les femmes engagées dans le mouvement du commerce équitable incarnent l’empouvoirement[20].
En ce qui concerne le « pouvoir d’agir », Anak Bunnak mentionne l’insertion de femmes rurales ou porteuses de handicap sur le marché du travail : « VillageWorks joue un rôle important dans l’empowerment [économique] des femmes [rurales]. Beaucoup de femmes dépendent d’un homme comme seul ou majeur gagneur d’argent [pour le foyer]. Le fait que les femmes qui travaillent pour VillageWorks travaillent à domicile est plus facile pour elles, elles peuvent contribuer au revenu du foyer ». En ce qui concerne plus particulièrement les femmes porteuses de handicap, « elles s’autonomisent, elles ne doivent plus dépendre du reste de la famille ». Anak Bunnak souligne aussi que les artisanes développent de nouvelles compétences, car VillageWorks propose des formations d’artisanat ; mais aussi des connaissances sur la chaine d’approvisionnement du commerce équitable.
Les bénévoles parlent de développement de compétences diverses (comptabilité, vente, gestion d’équipe, sensibilisation et formation, etc.) et de connaissances, notamment sur les problématiques de l’industrie textile. Elles mentionnent aussi une certaine envie de réfléchir/remettre en débat des paradoxes, réfléchir le monde : « Je suis parfois dans une position inconfortable : je n’achète pas de fruits du Chili mais on vend du vin du Chili – il y a des fois un paradoxe sur ce qu’on propose. [On] débat sur les procédés et sur les prix et l’équité des choses. Dans [tel] cas, qu’est-ce qu’on fait ? On privilégie le local ? C’est un vrai débat. » Ceci peut mener au développement d’une capacité de sensibilisation des autres : « Parfois, la clientèle a des préjugés aussi. Ça arrive souvent, et c’est lié à la méconnaissance, ce n’est pas négatif. »
En ce qui concerne le « pouvoir intérieur », les travailleuses rurales de VillageWorks, qui gagnent un salaire pour le foyer, « gagnent aussi une meilleure voix et position dans le foyer, elles se sentent plus en confiance pour s’affirmer ». Quand on lui demande ce qui la rend la plus fière dans son travail, Anak Bunnak évoque l’émancipation intérieure de femmes porteuses de handicap : « Je pense à une femme, qui a la polio, qui ne travaillait pas et était à la rue. Elle est devenue superviseuse en contrôle qualité. Elle a son propre boulot, elle est très responsable, elle apprécie l’entreprise. Elle n’a plus besoin de personne pour l’aider dans le contrôle qualité, elle supervise elle-même d’autres personnes. La meilleure chose, ce n’est pas qu’elle a un boulot, mais surtout de voir qu’elle prend des responsabilités ». De manière générale, Anak Bunnak souligne le développement de conscience de sa valeur et de celle de son travail, d’estime de soi et de confiance en soi chez les travailleuses de VillageWorks : « Elles se sentent moins seules, elles partagent leurs difficultés avec d’autres femmes, elles sont plus confiantes en elles-mêmes, en leurs compétences, elles développent un sentiment d’indépendance, elles sont contentes de faire ce qu’elles font et fières de leurs réalisations, elles connaissent mieux leurs droits… Anak Bunnak précise encore : « Elles se révèlent et deviennent plus visibles [dans leur communauté, et dans le monde]. Elles ouvrent leur esprit et voient ce qu’il se passe dans le monde ».
Du côté des bénévoles, l’on parle de réaliser la valeur de son travail et de son engagement ; mais aussi de réaliser qu’elles font partie d’une chaine de solidarité et d’engagement qui traverse les frontières : « Avoir rejoint la boutique Oxfam fait que j’adhère à un projet qui me dépasse – [ce qui compte le plus, c’est] le vivre ensemble, l’interaction, l’interdépendance. Les bénévoles soulignent aussi l’intérêt du contact social, la sortie d’aborder des difficultés du foyer lors du bénévolat (parler de violences conjugales) ou la sortie de la solitude : « Il y a des personnes qui viennent pour rompre la solitude, et d’autres qui viennent plus pour le projet. » Les bénévoles parlent du développement de la confiance en soi et du sentiment d’utilité, via la reconnaissance et la valorisation de leur engagement et compétences par la clientèle. Elles soulignent, enfin, la prise de responsabilité de certaines bénévoles.
En ce qui concerne le « pouvoir collectif », Anak Bunnak mentionne la transformation des normes de genre locales, via le pouvoir de l’exemple, et le fait que les tâches divisées entre hommes et femmes (hommes au champ[21], femmes au foyer) changent petit à petit, vers davantage d’emploi féminin : « Nous discutons de genre de manière informelle [dans les villages]. Nous choisissons un bon exemple, une femme leadeuse dans le village, elle sert de role model. Nous la montrons [au reste du village], nous montrons à quel point ça fonctionne pour elle dans sa famille, sur son lieu de travail, que tout le monde soutient tout le monde dans sa famille. Ainsi, d’autres personnes peuvent être inspirées par ce modèle ». Anak Bunnak aborde aussi le changement des mentalités au niveau des normes genrées en ce qui concerne le soin aux enfants et la charge domestique : « Aujourd’hui, beaucoup d’hommes encouragent leur épouse à avoir un emploi. Les enfants voient leur mère avoir un emploi, c’est bien. Mais la difficulté, c’est que [les hommes] attendent désormais des femmes qu’elles aient un emploi ET s’occupent des enfants et des tâches domestiques en même temps. Cependant, [on voit une évolution], ce n’est plus seulement ‘ça c’est une tâche d’homme et ça c’est une tâche de femme’, maintenant, c’est aussi la personne qui a du temps libre qui prend la responsabilité d’une tâche [domestique] ».
Les bénévoles ne sont pas en reste, en ce qui concerne le « pouvoir collectif ». Si l’emploi féminin et le changement des mentalités en ce qui concerne la charge domestique ne sont pas abordés, elles parlent en revanche beaucoup du fait de s’impliquer en commun pour un changement de modèle dans leur communauté, leur quartier, leur région. Les bénévoles soulignent l’intérêt de s’organiser en collectif (équipes), du travail exécuté en commun et de la recherche d’égalité dans les moments de prise de décision : « Ça correspond à des valeurs que je défends. Un projet que j’ai envie de rejoindre. » Elles parlent aussi de la solidarité au sein de l’équipe, du fait que l’on se soutient, pour des problématiques liées à son bénévolat comme à des problématiques personnelles. Les bénévoles mentionnent le fait de « faire mouvement toutes ensemble », et le pouvoir de l’exemple, en étant actives dans un mouvement de commerce équitable, sur le reste de la société : « Est-ce qu’on n’a pas un pouvoir d’influence, vu notre nombre, dans le secteur social, par exemple ? » Une préoccupation se porte aussi sur le soutien, au niveau mondial, d’un artisanat de qualité et de « redonner » ses lettres de noblesse à l’artisanat en Belgique : « On explique, mais on est un peu l’exception, ici. Le concept même d’artisanat n’est plus compris par la clientèle jeune. En ville, il n’y en a presque plus [des artisan·e·s] […] Même s’il y a plus de jeunes qui se lancent dans l’artisanat [en Belgique] depuis le covid ».
En résumé, nous constatons donc une série de points communs dans l’empouvoirement vécu par des femmes (de profils pourtant assez différents) qui s’engagent dans le mouvement du commerce équitable : développement de compétences et de connaissances ; développement d’un sentiment de fierté et d’utilité lié au travail ; meilleure estime et confiance en soi ; ouverture à une pensée mondiale, sentiment de faire partie d’une chaine de solidarité mondiale ; prise de responsabilités ; développement d’une assurance et d’une « solidité » pour prendre une place publique, dans son foyer ou sa communauté ; diminution de la solitude et réseau d’autres femmes avec qui échanger ; volonté d’être un exemple et d’inspirer autour de soi par son mode de vie ; organisation en collectif.
Quelques réserves et précautions
Le mouvement du commerce équitable est pluriel, constitué d’organisations et de personnes distinctes et issues d’horizons multiples, aussi différentes qu’Oxfam-Magasins du monde ou VillageWorks peuvent l’être. Pourtant, ces deux organisations se rencontrent dans leur réalité autour d’un concept commun : l’empouvoirement. Si les personnes qui ont initié le mouvement du commerce équitable n’ont pas visé, à l’origine, à en faire un « mouvement de femmes », force est de constater que le commerce équitable permet à de nombreuses femmes de s’y retrouver, dans un engagement salarié ou bénévole.
Pour autant, cela soulève de nombreuses questions et remarques, à se poser autant en interne que dans l’entièreté du mouvement du commerce équitable. Parmi celles-ci :
- Rien n’est dit sur l’implication (très) majoritaire des femmes bénévoles adultes (90%) chez Oxfam-Magasins du monde. Pourquoi les femmes s’impliquent-elles massivement chez OMdm, les hommes, très peu ? Cela est-il dû en majorité à la thématique du commerce équitable ? Ou à la façon dont le bénévolat est vécu en Belgique ?
- Le mouvement du commerce équitable doit-il « être un mouvement de femmes » ? Devrait-il le rester ? Devrait-on chercher à recruter davantage d’hommes ? Si c’est déjà le cas, qu’est-ce qui « empêche » les hommes de s’impliquer dans ce mouvement ?
- Comment désinvisibiliser et mieux valoriser le travail des femmes ? Tout en dé-geanrant certaines tâches, et en permettant au mieux aux femmes d’articuler vie professionnelle et charge domestique (tout comme les hommes) ?
- Quelles sont les limites de ce concept « d’empouvoirement » appliqué aux artisanes ?[22] Comment ne pas se retrouver « coincé » dans une vision purement néolibérale, où l’accès des femmes au marché mondial représenterait la panacée ?
Il s’agit de rester nuancé quand on utilise le concept d’empouvoirement, de ne pas oublier les difficultés restantes, tout en acceptant de souligner les intérêts de mobiliser ce concept dans le cadre du commerce équitable. Il s’agit également de renforcer les études sur les contributions des différentes organisations du mouvement du commerce équitable à l’émancipation des femmes, de l’organisation du mouvement et du pouvoir du collectif.
Merci à Anak Bunnak d’avoir répondu à nos questions ; merci encore aux participant·e·s des focus groups de l’été 2024 à Ath, Bruxelles, Louvain-la-Neuve et Neufchâteau.
Propos recueillis et/ou traduits par Manu Gonzalez, Simon Laffineur, Claire Mathot et Laura Pinault.
Anak Bunnak a reçu une traduction en anglais de cette analyse et l’a approuvée avant publication.
Notes
[1] Cette analyse ne vise pas à fournir un historique du concept ni à aborder ses déclinaisons dans différentes parties du monde. Pour un bref historique, lire : « L’artisanat équitable, outil d’empouvoirement des femmes ? » (2023), Pauline Grégoire pour Oxfam-Magasins du monde
https://oxfammagasinsdumonde.be/lartisanat-equitable-outil-dempouvoirement-des-femmes/
[2] Droit de vote à tous les types d’élections pour les femmes en Belgique en 1948.
[3] Droit pour une femme mariée d’ouvrir un compte en banque sans l’accord de son mari en 1976 en Belgique.
[4] En Belgique, loi autorisant la contraception en 1967 et loi de dépénalisation partielle de l’interruption volontaire de grossesse en 1990.
[5] Lire : « Femmes au sommet » (2024) de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, qui a étudié la participation des femmes aux postes de direction et décision, dans de nombreux secteurs : entreprises côtées en bourse, organisations syndicales et patronales, mais aussi médias, autorités académiques, monde politique, ordres des professions libérales, etc. https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/media/documents/188%20%20%CC%B5%20%20Femmes%20au%20sommet%202024_0.pdf
[6] Lire : « Egalité des genres dans l’espace public » (2023) du Service Public Fédéral Intérieur https://www.besafe.be/sites/default/files/2023-01/gender_fr_2_0.pdf
[7] Lire : « Women’s health report » (2024) de Sciensano https://www.belgiqueenbonnesante.be/metadata/hsr/Womens-health-report-2024_1.pdf
[8] Au-delà du « pouvoir sur », dimension négative du pouvoir, la dimension où l’on a du pouvoir sur les autres, du pouvoir coercitif.
[9] Des individus, mais, dans cette analyse, des femmes.
[10] Pour en savoir plus sur la notion d’empouvoirement, lire : « Genre et empoderamiento » (2009, réédition 2017) du Monde selon les Femmes https://www.mondefemmes.org/product/genre-et-empoderamiento-empowerment-meme-concept/
[11] L’enquête de Statbel de 2022 (https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/salaires-et-cout-de-la-main-doeuvre/salaires-mensuels-bruts-moyens ) indique les 10 métiers les plus rémunérés et les moins rémunérés en Belgique.
[12] https://www.talent.brussels/fr/actualites/la-place-des-femmes-dans-les-fonctions-dirigeantes-ou-en-est-613635
[13] https://www.forbes.be/fr/moins-de-20-des-informaticiens-belges-sont-des-femmes/
[14] https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/les-professions-en-belgique
[15] Il n’existe pas de chiffre unique et global pour le nombre de femmes travaillant dans l’artisanat au niveau mondial. L’on estime que, selon les contextes et les pays, la proportion de femmes dans ce secteur oscille de 25% à 50%. Par ailleurs, l’on connait souvent dans l’artisanat une division des métiers ou des tâches fortement genrée, avec une présence prépondérante des femmes dans tout ce qui concerne le textile. Il y a aussi une division genrée en terme « d’importance » et de professionnalisation des métiers. Pour une idée sur cette thématique, lire : https://www.europeana.eu/fr/stories/women-and-crafts
[16] En tant qu’organisation importatrice de commerce équitable, et en particulier, d’artisanat.
[17] Le chiffre de 56% recouvre les organisations productrices d’alimentation et d’artisanat équitable. Si l’on regarde l’artisanat – qui représente un secteur d’emploi conséquent pour les femmes, ce chiffre monte à 68 % (soit 21 organisations, sur les 31 organisations partenaires d’artisanat, fournisseuses directes et actives, d’Oxfam-Magasins du monde au printemps 2025).
[18] Les organisations représentées étaient : CRC, Ema, Sasha et Tara Projects.
[19] Cette étude est disponible à la lecture : « Comprendre les concepts de genre et de féminisme. Une étude auprès de notre public bénévole adulte » (2024), Pauline Grégoire pour Oxfam-Magasins du Monde https://oxfammagasinsdumonde.be/genre-et-feminisme-ce-que-revele-notre-etude-aupres-des-benevoles/
[20] Les propos d’Anak Bunnak proviennent de l’entretien qu’elle nous a accordé le 13 mai 2025, dans nos locaux de Louvain-la-Neuve. L’entretien s’étant déroulé en anglais, la traduction et le rapportage des propos d’Anak Bunnak ont été réalisés par nos soins. Anak Bunnak a reçu une traduction en anglais de cette analyse et l’a approuvée avant publication. En ce qui concerne les propos des bénévoles, ils proviennent des focus groups réalisés lors de l’été 2024 (méthodologie disponible dans l’étude citée ci-dessus).
[21] Dans les villages ruraux où travaillent les groupes de productrices de VillageWorks, la grande majorité des foyers vivent de l’agriculture, secteur où les hommes sont fortement actifs.
[22] Pour quelques études de cas, l’intérêt et les limites de ce concept, lire « L’artisanat équitable, outil d’empouvoirement des femmes ? » (2023), Pauline Grégoire pour Oxfam-Magasins du monde https://oxfammagasinsdumonde.be/lartisanat-equitable-outil-dempouvoirement-des-femmes/