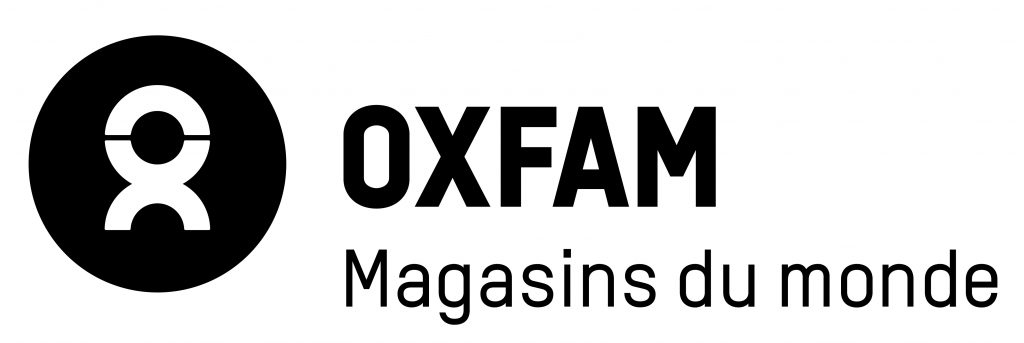Résumé
Malgré un soutien à la transition agroécologique de plus en plus apparent politiquement en Belgique, la réalité est toute autre. Une étude du laboratoire SYTRA-UCL montre ainsi que les financements publics de la RW pour l’agroécologie sur la période 2019-2024 sont cantonnés à un modeste 10%. L’étude recommande donc d’augmenter ces financements, dans une approche à la fois radicale (ambitieuse) et inclusive (accessible à un large public).
Télécharger cette analyse en version PDF
Le soutien à la transition agroécologique semble de plus en plus présent dans les discours et les engagements politiques en Belgique. Rien qu’en Région Wallonne (RW), on peut citer comme exemples récents le ‘Plan de transition agroécologique’, le ‘Plan Relocaliser l’alimentation’ ou encore le ‘Plan de développement de la production biologique à l’horizon 2030’[1]. Mais qu’en est-il réellement dans la réalité des faits et des chiffres ? Ces quelques « arbres » de politiques à tendance agroécologique ne cachent-ils pas une « forêt » de financements classiques privilégiant en grande majorité le modèle agro-alimentaire dominant ? Une étude récemment publiée par le laboratoire de recherche SYTRA-UCL permet de dresser un tableau plus objectif et complet de la part destinée à l’agroécologie dans les financements publics wallons. En voici une brève analyse, comme premier élément de réponse à l’une des principales revendications de la campagne agroécologie d’Oxfam-Magasins du monde : un soutien financier accru à l’agroécologie en Belgique.
Le principal objectif de l’étude du SYTRA – quantifier les réels investissements à l’agroécologie en RW, afin de mieux cerner le degré de cohérence entre ces financements et les (déclarations) politiques – part d’un constat simple : le faible soutien à l’agroécologie au niveau mondial, relativement bien documenté.
Un faible soutien au niveau mondial
Dans un rapport de 2019 de son groupe d’experts de haut niveau (HLPE, pour l’anglais « High Level Panel of Experts »), le Comité pour la Sécurité Alimentaire (CSA) indiquait ainsi que l’investissement public dans les approches agroécologiques était estimé à 1-1,5 % des budgets totaux consacrés à l’aide au développement et à l’agriculture. Selon l’organisation, la plupart des investissements privés et publics effectués au cours des 50 dernières années dans la recherche agricole ont porté essentiellement sur les technologies de la « Révolution verte » (notamment les produits chimiques agricoles et la mécanisation) et plus particulièrement sur la génétique[2].
Autre exemple dans le domaine des politiques de développement, une publication datant de 2020 rapportait que 0% des fonds de coopération de l’UE transitant via la FAO, le FIDA et le PAM entre 2016 et 2018 avaient soutenu l’agroécologie transformatrice[3], le tableau étant presqu’aussi sombre pour des pays tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, la Belgique, le Danemark, le Kenya ou les États-Unis[4]. Selon l’ONU, l’écrasante majorité (87 %) des subventions publiques allouées à l’agriculture dans le monde aurait des effets potentiellement délétères pour le climat, la biodiversité, la santé et la résilience[5].
En termes de politique nationale, l’une des seules études identifiées montre que le soutien financier de la France – un pays qui se revendique pourtant comme leader en agroécologie – à son système alimentaire est très largement incompatible avec la durabilité[6].
Ces différents exemples (inter)nationaux indiquent la nécessité de dresser un tableau objectif et complet de la part des financements publics destinée à l’agroécologie en RW si l’on veut pouvoir plaider pour un alignement des moyens financiers avec les discours.
Périmètre et méthodologie de l’étude
Dans ce but, la recherche du SYTRA a d’abord consisté à cartographier les flux financiers publics à destination des secteurs agricole et alimentaire en Wallonie. Différentes lignes budgétaires gérées par la RW (administrations et cabinets ministériels en agriculture, environnement et santé) ont été analysées à l’aide de mots clefs pour déterminer le budget total consacré aux systèmes alimentaires. La période considérée était de 2019 à 2024, ce qui a permis d’évaluer les actions de l’actuelle législature tout en intégrant les deux PAC (l’ancienne de 2014 à 2022 et la nouvelle de 2023 à 2027).
Pour estimer le caractère agroécologique de ce budget consacré aux systèmes alimentaires, une méthodologie développée par le laboratoire de Coventry au Royaume-Uni (Moeller et al., 2023) a été utilisée[7]. Cette méthodologie, de nature qualitative, consiste à lire les descriptions de projets pour y attribuer des scores agroécologiques en fonction des 13 principes de l’agroécologie du HLPE. La moyenne de ces notes, variant de 0 (‘business as usual’) à 2 (agroécologie transformatrice), donne une note globale quantifiant le caractère agroécologique des projets.
Pour éviter que des projets au champ d’action trop restreint (par exemple un financement dans le secteur céréalier, sans lien avec le principe #4 de santé animale) soient exclus ou notés négativement, il est possible d’attribuer un « non applicable » (n/a) sur certains principes. Cependant, 4 principes, considérés comme cruciaux pour une approche systémique de la transition, ne peuvent être notés « n/a » (et ont donc une note de « 0 » si le projet ne les aborde pas) : cocréation de connaissances, valeurs sociales et régimes alimentaires, équité, participation. A noter également que l’outil intègre 13 « points d’exclusion » ou « Red lines ». Il s’agit de certaines pratiques qui mènent l’ensemble du projet à zéro, peu importe les autres contributions agroécologiques (par exemple l’introduction d’OGM ou le soutien à l’élevage industriel).
Les financements qui présentent une contribution mesurable à l’agroécologie (score > 0%) font l’objet d’une seconde analyse. Celle-ci consiste à multiplier le budget d’un financement par son score agroécologique, ce qui permet de chiffrer la part du montant soutenant « effectivement » l’agroécologie (autrement appelé « budget pondéré »). Par exemple, pour un financement de €100.000 ayant obtenu un score agroécologique de 30%, seuls €30.000 sont considérés. La somme globale de ces résultats donne la part finale des financements soutenant « effectivement » l’agroécologie en RW.
Comparée aux nombreuses autres existantes, cette méthodologie a l’avantage d’être relativement simple à utiliser, tout en bénéficiant d’une forme de reconnaissance internationale[8]. Elle a cependant été conçue avant tout pour des projets de coopération à l’international, elle a donc dû être adaptée au contexte wallon. A noter également que du fait, entre autres, du manque de données, l’évaluation a reposé sur les intentions d’action de chaque projet (sur base de la description des financements) et non sur l’analyse individuelle des résultats. Une partie des financements a également dû être exclue, par manque d’information sur la description du projet ou dans le cas où aucun montant était identifiable.

Principaux résultats
Les principaux résultats de l’étude (Tableau 1) révèlent que sur un budget global de €2,485 milliards alloués entre 2019 et 2024 aux secteurs agricole et alimentaire et ayant pu être analysés, seuls 10% sont effectivement consacrés à l’agroécologie. Cela démontre un intérêt existant mais limité pour la thématique en RW. A noter cependant que 37% de ces financements ont une contribution mesurable à l’agroécologie, c’est-à-dire obtiennent un score supérieur à zéro.

Tableau 1. Répartition du budget selon la contribution à l’agroécologie.
Au-delà du pourcentage global, il est intéressant d’examiner la provenance des 10% obtenus. L’analyse par ministère (Tableau 2) montre que le ministère de l’agriculture, malgré un budget global très largement majoritaire dans le total des financements analysés (95,7%), ne contribue effectivement à l’agroécologie qu’à hauteur de 9%. A l’inverse, le ministère de l’environnement, qui ne contribue que pour 4% au budget global, soutient effectivement l’agroécologie à hauteur de 41%.

Tableau 2. Répartition du budget entre ministères.
Un contraste similaire apparait en faisant l’analyse par instrument financier (Tableau 3). Certains d’entre eux obtiennent un bon score mais ne contribuent finalement que peu à l’agroécologie du fait d’un budget limité. Malgré un score de 80%, le plan d’action Food Wallonia ne contribue ainsi que pour 4% au budget total soutenant effectivement l’agroécologie, cf. son budget de seulement €13 millions. A l’inverse, la PAC Premier Pilier 2023-27 (€669 millions), bien que n’octroyant que 5% de son budget à l’agroécologie, contribue à hauteur de 14 % au budget total soutenant effectivement l’agroécologie.
Finalement, les contributeurs les plus importants aux 10% sont des instruments combinant un budget significatif et un score moyen. On retrouve par exemple dans cette catégorie le CRA-W et l’APAQ-W, qui représentent respectivement 22 et 19% de l’enveloppe des 10%. Le score combiné de 19% obtenu par ces deux OIP[9] s’explique notamment par un soutien relativement important à l’agriculture biologique (qui représente par exemple 20% du budget de recherche du CRA-W).
Le Plan de relance de la Wallonie (PRW), constitué de nombreuses et diverses lignes de financements (ex. le plan de transition agroécologique Terrae ou la phase II du plan Relocalisation), est un cas particulier. Grâce à un score de 34% et un budget de €159 millions, il contribue pour 22% à l’enveloppe des 10% effectivement consacrés à l’agroécologie. Mais ce bon résultat est à relativiser car ce financement est ponctuel et d’origine européenne, résultant de la volonté de l’UE, dans le contexte post-COVID, de relancer l’économie. Sans cet « effet d’aubaine », il est probable que ces projets à fort impact agroécologique n’auraient pu être financés, ou moins généreusement.

Tableau 3. Résultats par instrument selon l’ordre décroissant de budget pondéré (% de budget soutenant effectivement l’agroécologie).
Limites de l’étude
Les auteurs/trices de l’étude soulignent combien celle-ci comporte des limites. Au niveau méthodologique tout d’abord, ne sont analysées pour rappel que les intentions des projets et non leur impact réel. De plus, l’outil d’évaluation utilisé, basé sur les 13 principes HLPE, ne capture pas nécessairement toutes les nuances de la réalité sur le terrain.
Cet outil est en outre particulièrement exigeant, à cause notamment des 4 principes obligatoires (cocréation de connaissances, valeurs sociales et régimes alimentaires, équité, participation). De ce fait, des financements plus centrés sur certains aspects agronomiques, tels que les éco-régimes du 1er pilier de la PAC, obtiennent des scores plus bas car ils sont notés zéro sur ces 4 principes obligatoires. De même, des projets centrés sur la création ou diffusion de connaissances, tels que les projets Terrae de recherche-action ou de sensibilisation, ont des scores plus bas (de 50 à 60%) que des projets plus holistiques sur les systèmes alimentaires (ex. du plan Relocalisation qui obtient un score de 83,3% grâce à des évaluations élevées sur les principes de diversification économique, cocréation, connectivité[10], participation, etc.).
Cela s’explique entre autres par le fait que l’outil a été conçu principalement pour des projets de coopération internationale, un secteur exigeant en termes de suivi (documentaire), d’impacts et de cohérence des projets. En comparaison, la documentation des projets et actions menés en RW n’est pas aussi exigeante, ou du moins n’est pas cadrée par un format type de rapportage, ce qui entraine une grande variabilité dans le niveau de détail partagé.
De fait, et c’est un autre de ses constats, l’étude met en évidence la complexité administrative au sein de la RW, notamment en ce qui concerne le manque de données publiquement accessibles, ce qui peut constituer un véritable frein pour piloter efficacement la transition et identifier les domaines d’intervention prioritaires.
Conclusions
L’étude démontre un financement public existant, mais modeste (10%), pour l’agroécologie en RW sur la période 2019-2024. La majorité des financements étudiés ont des scores agroécologiques allant de 0% à 40%. Ce faible soutien à l’agroécologie peut en partie s’expliquer par le système de cotation relativement strict de l’outil d’évaluation. En particulier, l’intégration obligatoire de 4 principes défavorise les projets moins systémiques et plus spécialisés, qui constituent encore la majorité des financements (ex. réduction des intrants chimiques en agriculture).
Au-delà du score agroécologique, la taille des financements représente un facteur clé dans leur contribution effective à la transition agroécologique. Des financements majeurs, tels que ceux de la PAC, ont un impact significatif malgré un faible soutien aux différents principes de l’agroécologie. En revanche, des financements fortement agroécologiques, mais peu dotés budgétairement, n’ont qu’un impact modéré (même s’ils ont un rôle précurseur / exploratoire important, qui peuvent déclencher d’autres investissements plus conséquents).
Ces résultats démontrent la nécessité de non seulement augmenter les financements pour l’agroécologie, mais également de dépasser la nature adaptative des projets soutenus. Autrement dit de financer massivement des projets à la fois radicaux (i.e. correspondant à une agroécologie réellement transformatrice) et inclusifs (i.e. pouvant atteindre une majorité d’acteurs/trices des systèmes alimentaires wallons).
Finalement, l’étude a permis d’identifier d’importantes contraintes liées à l’accessibilité des données de financements publics et au niveau de détail des informations disponibles. Dans un souci de transparence et redevabilité de la région d’une part, et de pilotage politique d’autre part, il apparait essentiel de renforcer le suivi structuré et systématique de ces données.
Patrick Veillard
Mai 2024
[1] A comparer avec les plans des deux autres Régions en Belgique : la ‘Stratégie Good Food 2.0‘ de la Région Bruxelles Capitale (RBC) et en Région Flamande, les stratégies ‘GO4Food‘ et ‘biologische landbouw 2018-2022’.
[2] HLPE. 2019. Approches agroécologiques et autres approches novatrices. Pour une agriculture et des systèmes alimentaires durables propres à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition.
[3] Veillard P. Décembre 2022. Pour une agroécologie transformatrice. Analyse de différentes alternatives agricoles au regard de l’agroécologie. Analyse Oxfam-Magasins du monde.
[4] Coventry University, CIDSE. September 2020. Analysis of funding flows to agroecology. The case of European Union monetary flows to the United Nations’ Rome-based agencies and the case of the green climate fund.
[5] Le Monde. 14/09/2021. Les subventions agricoles jugées « néfastes sur le plan social et environnemental » par trois agences de l’ONU.
[6] L’étude analyse les financements publics et privés à destination des revenus et investissements des acteurs du système alimentaire français. Exemple, sur les €26 milliards de subventions publiques (aux revenus et à l’investissement)) et d’exonérations de taxes et de cotisations, très peu correspondent aux trois scénarios de durabilité retenus (Afterres, TYFA, et Stratégie nationale bas carbone). En particulier, les critères d’éligibilité des aides de la PAC sont en grande partie insuffisants – notamment les aides directes et paiements verts –, les règles encadrant les repas des cantines publiques ne correspondent pas à un régime durable, et l’usage de carburants fossiles bénéficie toujours d’exonérations de taxes. IC4E. Octobre 2021. Décryptage des financements du système alimentaire français et de leur contribution aux enjeux de durabilité.
[7] Moeller N. et al. November 2023. Measuring agroecology: Introducing a methodological framework and a community of practice approach. Elementa Science of the Anthropocene 11(1).
[8] L’outil est le résultat d’un travail collaboratif d’une communauté de pratiques sur le financement de l’agroécologie, en collaboration avec des chercheurs, des organisations de la société civile (OSC) et d’autres organisations et donateurs internationaux. Il a été développé au sein de (et est promu par) l’Agroecology Coalition, une structure internationale qui regroupe 43 pays, 3 structures régionales (l’UE, l’UA et la CEDEAO) et plus d’une centaine d’organisations. Voir aussi : Agroecology Coalition. October 2023. The agroecology assessment framework.
[9] Organismes d’Intérêt Public.
[10] En faisant une analyse par principe HLPE, on s’aperçoit d’ailleurs que c’est ce principe agroécologique de connectivité qui est majoritairement soutenu par la RW sur la période étudiée.